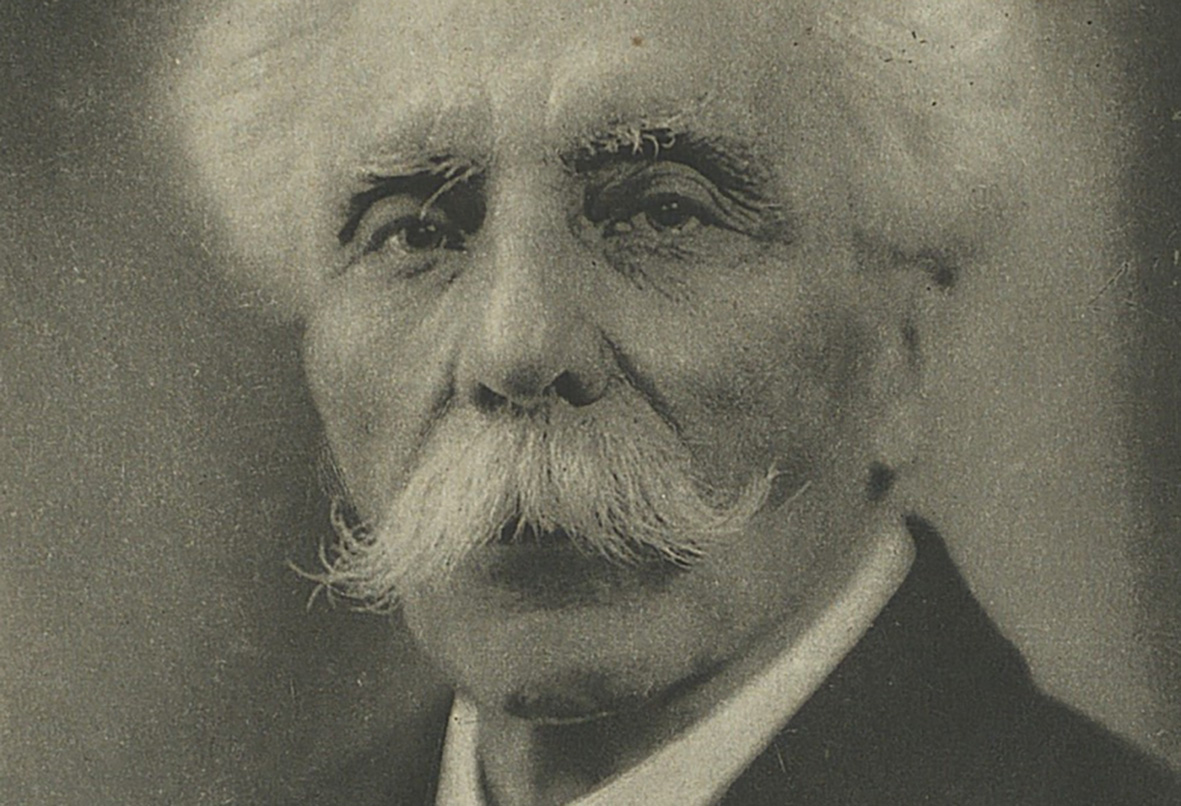Curieusement dans ce programme, ceux qui ont le moins convaincu sont l’Espagnole Sol León et l’Anglais Paul Lighfoot, tous deux chorégraphes résidents du NDT dont ils assurent la direction artistique depuis 2011. Conçue comme un hommage à la salle de répétition où ils ont dansé pendant 20 ans, la pièce Studio 2 recherche l’âme de la compagnie qui a imprégné les murs, les sols et les miroirs de ce lieu de travail. Mais cet hommage tombe dans l’effet inverse de celui escompté. Si l’on peut concevoir qu’elle soit la plus néoclassique des trois créations présentées, on est surpris de voir à quel point - dans son écriture - elle a du mal à se débarrasser de certains oripeaux de la danse classique pour nous délivrer, au final, une gestuelle plus narcissique que profonde. Et tous les ingrédients sont réunis pour formater une pièce faussement intense : la musique plombante d’Arvo Pärt (Tabula Rasa) qui alterne douceur, violence et crescendo ; la scénographie qui fait se mouvoir le sol puis un miroir géant censé refléter la partie non visible de la danse, et une danse qui va surtout chercher la pose et la juxtaposition d’intentions scéniques. Nous faisant rentrer en ce studio fantasmé, les deux chorégraphes nous maintiennent dans une distance et une posture de voyeur inintéressante.
La danse se libère
Mais très vite, le Suédois Johan Inger – ancien danseur du NDT et aujourd’hui chorégraphe associé – libère la danse pour nous embarquer dans un espace qui ressemble à un vaste désert où tout est possible. Sur des musiques blues de l’Irlandais Van Morrison, sa pièce I new then s’engouffre dans la jeunesse, la légèreté et la disponibilité des danseurs, entre fluidité, nonchalance, frémissements et pulsations corporelles et les fait sortir du formalisme de la précédente. Ici, l’écriture est plus axée sur le groupe vecteur d’une réelle énergie. Elle laisse aussi s’échapper des folies individuelles qui viennent en contre-point d’une unité chorégraphique, illustrant l’image du créateur qui cherche ou de l’interprète qui éprouve la sincérité de sa danse. Sous ses airs fugaces et affleurés, la danse d’Inger nous touche telle une rencontre importante et sensible.
Un final plein d’humour, de virtuosité et de musicalité
Le final est assuré par la déferlante Alexander Ekman, jeune chorégraphe suédois de 29 ans dont on avait aimé l’an dernier, Tuplet créé pour le Cedar Lake Contemporary Ballet. Avec Cacti, il s’empare de la virtuosité néoclassique de cette compagnie et s’en sert pour se moquer justement de ses codes mais surtout pour faire surgir la musicalité des corps. Ekman aime la danse, mais pas seulement. Il aime la vidéo, le travail plastique ou les installations chorégraphiques et beaucoup la musique. Et là, c’est du lourd : Haydn, Beethoven, Schubert. Mais non, ce n’est pas de la danse classique. Commençant à genoux, vêtus d’un pantalon noir et d’un haut couleur chair, identiques et asexués, les danseurs et danseuses sont chacun sur un carré de scène transportable. Le ton est donné, les corps sont dévoués tout entier aux rythmes et nous donnent très vite l’impression - par la rapidité de leur exécution - d’entendre une musique différente de celle que l’on croit connaître. Ekman emballe la scène avec des mouvements effrénés et beaucoup d’humour. Par moment, il transforme les danseurs en personnages de bande dessinée ou en robots accomplissant des gestes sans se poser de questions, allant jusqu’à les ridiculiser sous des douches de lumières dans des poses figées. Dans ce tourbillon scénique, il révèle le joli duo d’un couple où la danse se vêt d’une chair sensuelle et intime. En même temps que la danse s’apprend, les êtres se rencontrent. Puis, il finit sur un tableau drôle et surprenant où sur fond de scénographie blanche, les danseurs jouent avec des cactus bien verts tandis que certains posés sur leur corps s’érigent tels des sexes humains !
Nederlands Dans Theater 2, à la Maison de la danse, jusqu’au 16 février.