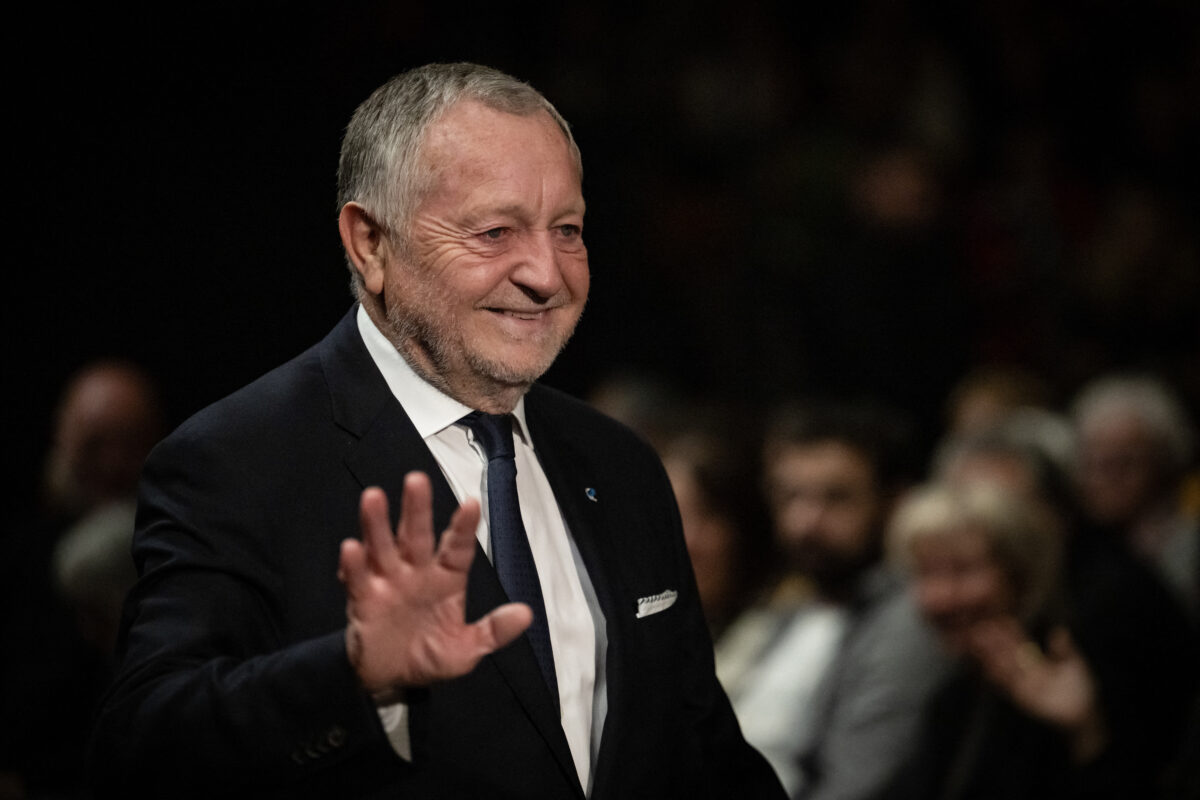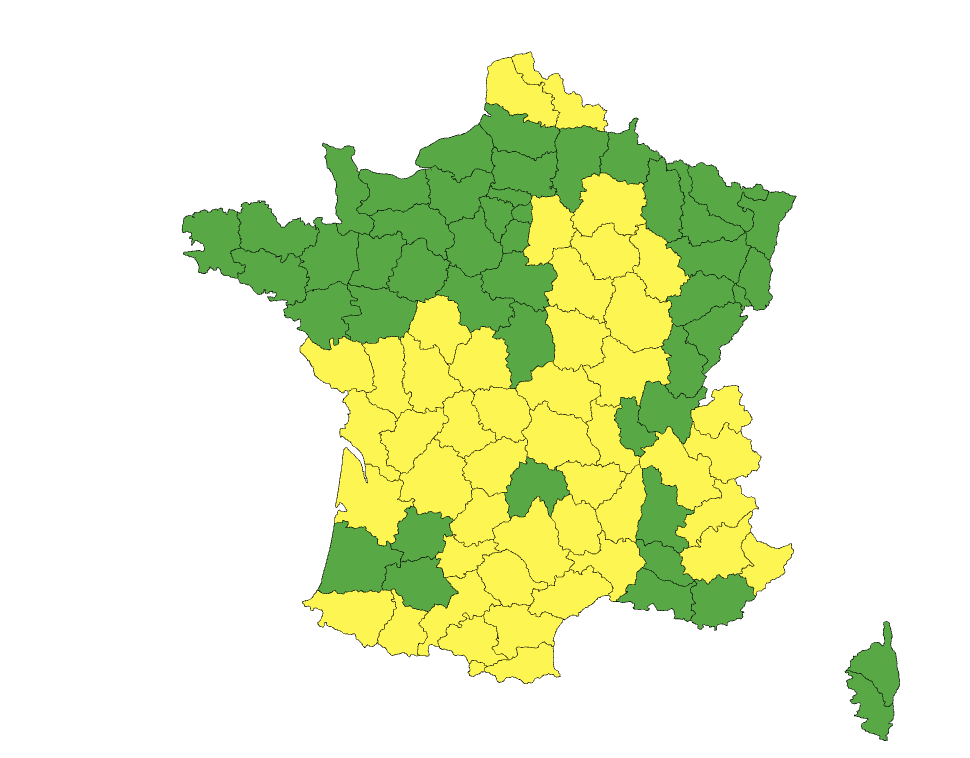Façade minimaliste et "Biribi" inscrit en capitales sur la vitrine. Un passant demande si on peut lui servir une bière. "Non Monsieur ce n’est pas un bar, c’est un salon de tatouage." La voix de Brassens mêlée à l’impulsion métallique de l’aiguille berce les lieux imprégnés de sérénité.
Clin d’œil "à la bousille", Biribi renvoie aux bagnes d’Afrique du Nord, alors colonie française, destinés à recevoir les militaires indisciplinés. L’identité du salon s’appuie sur les études des tatouages des ex-bagnards, menées par le médecin lyonnais Lacassagne*. Hommage ou véritable doigt d’honneur aux légendes qui veulent que le tatouage soit né sur les marins ou les prisonniers russes, Biribi puise ses origines dans la valeur "brute" et "efficace" du tatouage à la française. Rencontre avec quatre affranchis.
Ouvert en janvier 2015, Biribi est né sous l’initiative de Nowe. Issu d’un milieu ouvrier, ce personnage enragé et rebelle n’a pas tenu sur les bancs de l’école. Sans diplôme, il est aujourd’hui animé d’une immense "fierté de pouvoir exercer son métier en ayant échappé au système traditionnel". Graffeur et disciple d’Alex D.West, Nowe insiste sur la recherche historique pour nourrir sa patte. "J’ai feuilleté énormément d’archives, et au-delà de l’illustration, il y a une vraie documentation derrière mon travail". Très inspirés cartoon et années 50, ses books traduisent une griffe humoristique qui lui est propre : Nowe sillonne les frontières du politiquement correct et de l’humour noir. Parfois vêtu d’un tablier beige ciré, il revendique un retour à la spontanéité brute et pure du tatouage : "la base du tatouage sont les flashs et c’est ce que j’ai voulu transmettre avec Biribi. Je vois le tatouage comme un journal de rencontre, c’est l’expérience et l’instant qui priment."
La spontanéité est en effet le mot d’ordre pour cet espace singulier : Tony Weingartner propose de jouer ses tattoos aux dés ou aux fléchettes. S’inspirant des codes de la culture contemporaine, il utilise les logos de marques, l’iconographie qui nous entoure, de l’ondulation d’une plaque d’égout aux symboles du code de la route, et les détourne. "On n'a pas de tatouage traditionnel comme les Maoris, les Polynésiens, les Tahitiens…donc je travaille sur notre langage à nous, les occidentaux. Et je les détourne parce j’aime cette frontière entre la réalité et le fantasque." Ayant hérité de ses nombreux voyages une passion pour la spiritualité bouddhiste et l’harmonie japonaise, Tony insiste sur la relation particulière qu’un tatoueur a avec ses clients : "ce mélange de confiance, de douleur, de transe…le tout concentré sur un médiateur commun : la peau." En perpétuelle recherche d’innovation, il travaille sur des supports dont l’originalité est poussée à l’extrême comme…des feuilles d’essuie-tout.
Biribi s’inscrit dans une volonté de transgression, de délaisser les codes. Ayant aiguisé son coup de crayon en école d’art contemporain, Paolo Bosson a préféré s’émanciper des contraintes : "les murs c’était bien, mais j’avais besoin d’autre chose". Encouragés par ses professeurs, il devient l’apprenti de Xoïl à la frontière suisse. "Ce qu’il faisait ne me plaisait pas particulièrement, tout comme mes études. C’est comme ça qu’on apprend à savoir ce qu’on veut vraiment." A la fois modeste et conscient de sa chance, Paolo est impatient de sortir de l’artisanat pour passer artiste. "Désormais, et cela correspond à l’explosion du tatouage, les gens vont chercher une griffe, la patte d’un tatoueur en particulier. Je veux qu’on vienne me voir pour ça." Et c’est déjà le cas, avec ce qu’il appelle le freehand. Cette pratique consiste à ne pas faire de stencil (croquis que le tatoueur reproduit sur la peau du client), le futur tatoué se fait piquer directement à main levée. "C’est intense avec la personne, il y a une énorme relation de confiance qui s’installe, et toi t’as une pression énorme…et le jour où je perds cette pression je ne tatoue plus." Lucide, il affirme que cette soif de reconnaissance et de célébrité est parfois malsaine, mais que ce métier d’égo est l’aboutissement d’un rêve :"notre vie est un fantasme…"
L’unité et la force de Biribi résident aussi dans la complémentarité des tatoueurs qui l’animent. En parfait contraste avec la légèreté des motifs de Tony ou de Paolo, le travail de Vincent, aka All Cats Are Grey est véhiculé par l’émotion. La "beauté tragique et viscérale" de ses motifs s’explique par son ancrage dans la culture punk et hardcore, au sein de laquelle le tatouage est un art omniprésent. Autodidacte et discret, Vincent a manipulé sa première aiguille pour piquer ses proches : "ça me paraissait inaccessible comme milieu, j’avais très peu confiance en moi." S’inspirant des iconographies des milieux alternatifs et des gravures de Félix Vallotton, l’univers d’All Cats Are Grey s’appuie sur la poésie dramatique, intégrant à ses techniques une recherche sur le contraste, "très important pour l’équilibre du tatouage", "le jeu des lignes" et "le poids des formes". Une aiguille entre les mains, ce personnage à la fois simple et sensible s’avoue parfois apeuré par le milieu du tatouage dont il récuse "le côté compétitif". "L’essentiel est que cela soit fait pour les bonnes raisons, et de manière honnête, comme la musique… De toute façon, on essaie de faire les choses à notre façon, sans voler la vedette à personne..."
*En France, le soigneux recensement de tatouages des criminels fait par Alexandre Lacassagne est l’exemple le plus connu. Ayant relevé plus de 2 500 tatouages de détenus, Lacassagne les catégorise par thème (inscriptions, professionnels, amoureux ou érotiques…). Pour lui, "le tatouage est un précieux signe d’identité" ; il les appelle "les cicatrices parlantes".
Biribi, 67 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
Nowe et Paolo Bosson seront présents à la Convention de Montpellier du 8 au 10 mai