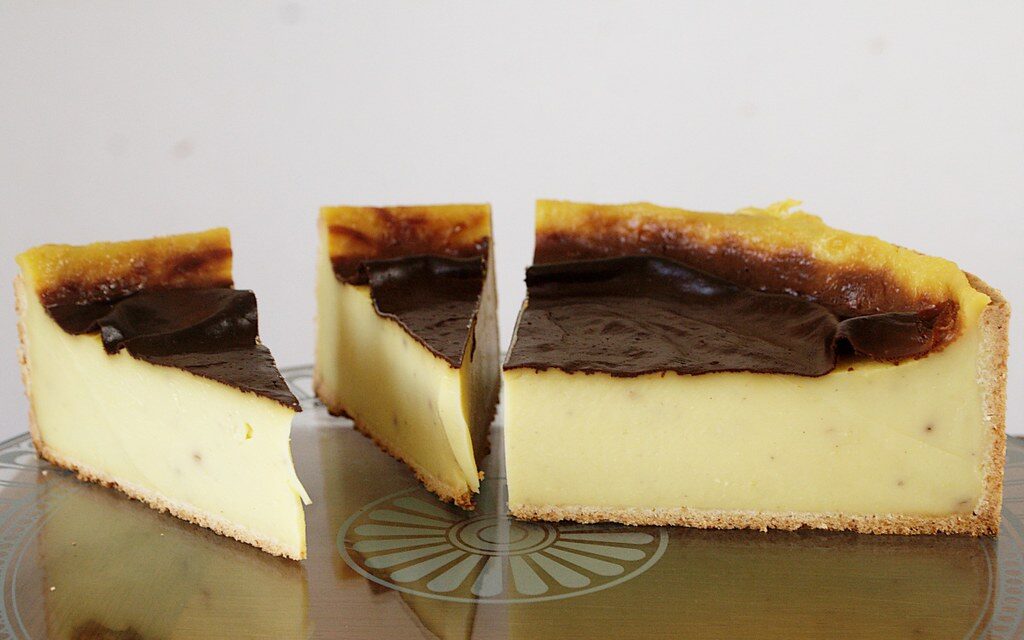Ils sont en première ligne face à la crise sanitaire. Sans eux, notre vie quotidienne serait profondément bouleversée. Portraits de héros ordinaires.
Première de caisse
À la caisse d’une petite supérette, Françoise voit défiler les angoisses des clients, leur comportement d’abord irrationnel et désormais plus humain. Elle savoure de ne plus être invisible aux yeux des consommateurs. Ce qui ne l’empêche pas de s’inquiéter de son exposition au virus.
Après des jours de folie, les supermarchés retrouvent un peu de calme. Mais pas leur visage habituel. Dans le 6e arrondissement de Lyon, des affichettes donnent les consignes à l’entrée d’une supérette : se tenir à un mètre les uns des autres, ne pas toucher de produits et acheter en quantité raisonnable chaque article. Françoise, caissière, gardera longtemps en mémoire les jours d’hystérie du début du confinement, se remémorant un temps qui semble désormais lointain : “Les gens achetaient n’importe quoi. Les clients ne nous laissaient même pas le temps d’enlever les films de protection sur les palettes, ils se jetaient dessus et les déchiraient. J’ai vu passer en caisse des produits que je ne connaissais même pas. Il y avait un côté fin du monde.”

Françoise s’amuse aujourd’hui des passades plus “survivalistes” que culinaires des Français : “Au début, c’étaient les pâtes et la farine. En ce moment, c’est le rayon œufs qu’ils dévalisent pour une raison que j’ignore.” Elle se souvient avoir dû raisonner un client qui avait vidé le stock de farine du magasin. “Son caddie était rempli.” De sa caisse, poste de vigie d’une consommation de crise, elle observe les clients qui désertent les fruits et légumes frais, coupables de pouvoir servir de refuge aux germes du Covid-19. Ils se reportent sur des produits emballés ou préparés. Au diable la diététique. Puis, les comportements irrationnels refluent. La raison revient : “Les clients sont plus tolérants. Ils respectent bien les procédures. Les gens nous remercient d’être là. Ça fait plaisir, c’est bien pour nous aussi, cela nous aide à surmonter les problèmes.” Lesquels sont avant tout sanitaires. Des masques sont arrivés, mais ils viennent rapidement à manquer. “Je porte le même depuis deux jours”, glisse-t-elle.
Des gants et du gel hydroalcoolique complètent le paquetage d’urgence. Aux caisses, des bâches en plastique ont été rajoutées. “Nous sommes quand même inquiètes. Nous sommes exposées.” La prise de risques est adoucie, dans l’attente d’une prime exceptionnelle, par le sentiment d’œuvrer pour l’intérêt général. “Avant, les clients passaient devant nous avec leurs écouteurs et disaient à peine bonjour. Ils ont pris conscience que nous ne sommes pas invisibles. Ils sont plus souriants. Ils ont des mots gentils, nous disent merci.”
Paul Terra
--
L’altruisme comme antidote
Sigolène Tyrol est cadre de santé dans l’unité neuro-vasculaire (UNV) de l’hôpital des Charpennes.

“Si, dans les occupations qui remplissent presque tout notre temps, nous ne suivons d’autre règle que celle de notre intérêt bien entendu, comment prendrions-nous goût au désintéressement, à l’oubli de soi, au sacrifice ?” (Durkheim). En ces temps difficiles, l’altruisme est un antidote. Sigolène Tyrol en a fait la source, la racine germée de toute sa vie. Engagée religieusement, l’amour de l’autre, l’empathie, la compassion et la bonté sont des valeurs au cœur de sa pratique et de son éthique. Plus jeune, elle a travaillé pendant quatre ans au Bénin dans un dispensaire pour enfants gravement malades. Elle en a rapporté un profond sens de la commisération et une certaine lucidité sur la maladie. Ancienne chef infirmière à l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison Saint-Luc-Saint-Joseph, puis de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, Sigolène est depuis 2001 cadre de santé à l’hôpital public gériatrique des Charpennes. “S’occuper de nos anciens est important. D’autant plus que quand ils arrivent dans notre service, ils sont dans des conditions de détresse physique et psychique parfois considérables. En Afrique, on a coutume de dire qu’un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle...” Le service dont elle s’occupe est une unité neuro-vasculaire. Très innovant, celui-ci permet la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Angoisse et solidarité
“Avec le coronavirus, c’est extrêmement compliqué car les patients que nous accueillons ici sont les plus fragiles, avec une forte comorbidité (hypertension, obésité, diabète, etc.).” Ceux qui présentent les symptômes du coronavirus – et ça arrive – sont alors immédiatement isolés dans une chambre, “pour protéger les autres patients” et dirigés dans des services dédiés (à Croix-Rousse ou Édouard-Herriot). S’il y a les patients, il y a également les trente-trois personnels soignants. Le travail est déjà lourd mais avec l’arrivée de cet invisible, tout devient plus difficile à gérer car le traitement n’est pas encore connu. “Les filles ont peur de contracter le virus et de le transmettre à leurs proches. Ça génère de temps à autre des tensions. Une mère de famille me disait qu’elle ne dormait plus avec son mari. Il faut les rassurer, prendre du temps pour en parler. Quand on se focalise sur la peur on est moins réceptif à l’organisation du travail. Il ne faut pas non plus trop psychoter. L’humain est donc fondamental dans cette période. Mais paradoxalement, j’observe énormément de solidarité, une sorte de bienveillance. Il y a certes de l’angoisse mais beaucoup de détermination. On s’entraide, on se serre les coudes. Il nous faut cette force intérieure pour se dire qu’on va s’en sortir.” Le sacrifice pour les plus faibles. Une jolie leçon de vie.
Guillaume Lamy
--
Transporter les malades coûte que coûte
Pour l’heure, dans le Rhône, les taxis n’ont pas été réquisitionnés par l’État. Mais ils sont nombreux, comme Mickaël, à œuvrer au bien-être des malades.
Dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi conventionné*, Mickaël, 29 ans, transporte chaque jour des patients qui doivent absolument se rendre dans les différents hôpitaux de la métropole de Lyon. Dès le début du confinement, si certains de ses confrères ont préféré renoncer à poursuivre leur activité, pour Mickaël, la question ne s’est même pas posée. “Je ne me voyais pas laisser tomber mes clients, assure-t-il. Je les transporte pour certains depuis que j’ai commencé ce métier, il y a environ deux ans et demi. On se connaît bien, on parle de nos vies respectives, j’ai créé un lien avec eux.” Cela dit, la pandémie de Covid-19 a forcément eu un impact dans son quotidien.

“Les personnes que je transporte sont dialysées ou elles ont un cancer donc elles sont fragiles. En ce moment, psychologiquement, c’est plus dur. Dans les premiers temps, j’avais peur de leur transmettre sans le savoir le virus. Je me suis déjà réveillé en pleine nuit en pensant à ça. Cela a un impact sur ma vie personnelle mais, fort heureusement, mon épouse me comprend et me soutient.” Afin de transporter ses clients en toute quiétude, Mickaël, qui porte un masque et des gants à chaque course, s’efforce de respecter consciencieusement les règles essentielles d’hygiène. “Je nettoie mon véhicule avec des lingettes désinfectantes, raconte le jeune homme. J’aère bien avant de prendre le premier patient qui doit s’installer impérativement à l’arrière afin de garder la bonne distance. Ma voiture est lavée entre chaque trajet.”
“Je fais juste mon travail”
S’il est sur le pont tous les jours de 7 h du matin jusqu’ à 18 h, avec de nombreux trous dans la journée, son activité est clairement impactée. “J’ai beaucoup moins de travail depuis le début du confinement puisqu’il n’y a plus d’entrée en hospitalisation ni de chirurgie ambulatoire. Il y a un gros manque à gagner. J’ai fait une demande d’aide financière mais j’attends un retour pour savoir si je suis éligible.” Malgré son dévouement pour ses clients depuis la crise sanitaire, Mickaël estime qu’il faut remettre les choses dans leur contexte. “Je ne suis pas un héros, je fais juste mon travail. Je ne suis rien du tout par rapport aux médecins, aux infirmières, au Samu, lâche-t-il. Le personnel soignant est méritant, il y a un manque de reconnaissance depuis trop longtemps. C’est dommage d’avoir attendu un tel drame pour s’en rendre compte.” Et de livrer une touchante anecdote en guise de conclusion : “Je transporte à l’hôpital Édouard-Herriot une petite mamie qui habite toute seule. Lorsque je la récupère, elle est toute triste et a le visage fermé. Une fois ses soins terminés, elle a le sourire, elle est heureuse car, me dit-elle, les médecins et les infirmières se sont bien occupés d’elle.”
Razik Brikh
* Il est lié à la Caisse primaire d’assurance maladie par une convention qui lui permet de proposer un transport sanitaire à ses clients.
--
“Ça fait chaud au cœur”
Producteur laitier, Mickaël Gonin apprécie de voir les regards changer sur le monde agricole en cette période de crise. Il espère que l’impact sera durable et se traduira aussi dans les choix des consommateurs.
Dans sa campagne, Mickaël Gonin n’avait jamais autant vu de promeneurs que depuis le début du confinement. “Mais ils se tiennent à distance les uns des autres”, glisse Mickaël, producteur laitier à Amplepuis dans une exploitation qu’il gère avec son frère. Son quotidien à lui n’a pas changé, toujours rythmé par ses 100 vaches. Seule concession au coronavirus, il désinfecte tout ce que le livreur de lait touche. En cette période de confinement, c’est son seul contact physique avec le monde extérieur. “La collecte du lait fonctionne toujours bien. Ma seule inquiétude, c’est l’aval, si des livreurs ou des usines de transformation devaient s’arrêter. Nous, les agriculteurs, avons de quoi nourrir la population, mais je ne maîtrise pas la suite de la chaîne d’approvisionnement.” Son lait, Mickaël Gonin le vend à Sodial qui le commercialise sous la marque Candia ou le transforme en yaourt, notamment pour Yoplait.

“Travailler pour un grand groupe offre une sécurité en ce moment”, sourit le producteur laitier. La crise économique qui menace a, jusqu’à présent, épargné les producteurs laitiers. “Avant le confinement, les Français ont fait du stock, nous arrivions tout juste à produire assez. Pour le moment, il n’y a pas encore de demande officielle de notre coopérative, mais je sens qu’ils ne poussent pas à la surproduction”, ironise Mickaël Gonin. De son exploitation et malgré la distanciation sociale, il sent un regard bienveillant se poser sur une profession qui avait mauvaise réputation ces derniers mois. “J’ai vu que, dans sa chanson, Jean-Jacques Goldman citait les agriculteurs. Ça fait chaud au cœur. On reprend notre place naturelle dans la société. Nous vivions un vrai mal-être social. La profession avait besoin de reconnaissance. Les routiers, tout comme les agriculteurs, ne sont pas considérés habituellement et les gens se rendent compte, aujourd’hui, que nous sommes utiles. Mais avec les réseaux sociaux, c’est un jour “je t’aime” et le lendemain “je te déteste”, prévient Mickaël Gonin. Pour lui, c’est à la sortie du confinement que se jouera la vraie reconnaissance : “J’espère que dans les rayons, les gens se rappelleront que l’on a assuré quand il le fallait et qu’ils regarderont où sont produits les aliments qu’ils achètent.” Il n’attend pas d’autres remerciements : “Ceux qui méritent des applaudissements, ce sont les personnels hospitaliers. Par rapport à eux, je me sens petit. Je ne fais que ma part.”
Paul Terra