Claire Crignon est docteur en philosophie au CNRS et maître de conférences de philosophie à l’université Paris-Sorbonne. Elle apporte un éclairage philosophique sur la crise que nous traversons, en convoquant les grands penseurs depuis Platon. Entretien.
Quel peut être le rôle du philosophe en temps d’épidémie/pandémie ?
Claire Crignon : Il faut prêter attention à ce que disent exactement les philosophes de la médecine. Le rapport de Platon à cette discipline est loin d’être dénué d’ambivalence. S’il loue le médecin, Platon insiste aussi sur la dimension approximative de la médecine comme art. Celui-ci est en même temps nécessaire aux hommes, mais il indique d’abord le fait que contrairement aux animaux, dotés de griffes, de carapaces, de cornes pour se défendre, nous naissons démunis, vulnérables, et que nous avons besoin de recourir aux arts et aux techniques pour survivre (cf. le mythe de Prométhée). Les maladies en général, les épidémies encore plus, viennent nous remémorer ce fait. Mais la médecine à laquelle nous pouvons faire appel aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec celle à laquelle Platon était confronté. Quel peut être le rôle du philosophe en temps d’épidémie ? Si on répond à partir de Platon, et qu’on reprend l’analogie qu’il construit, le philosophe ne peut pas grand-chose… Le médecin délivre le corps de ses maladies, le philosophe, lui, s’efforce de débarrasser l’âme de ses maux. Ainsi Socrate pratique l’art du dialogue et ce qu’on appelle la maïeutique (l’accouchement des âmes) pour délivrer les hommes de leur prétendu savoir et leur faire prendre conscience de leur ignorance. Il y a cependant un point commun entre les deux : cette opération de délivrance ou de guérison des maux ne sera pas perçue favorablement par la population. Comme l’explique Platon dans Le Gorgias, les hommes préféreront toujours un cuisinier qui concocte des plats agréables à un médecin qui prescrit des potions amères et des traitements déplaisants. De la même façon, les hommes préfèrent les sophistes, qui délivrent des discours plaisant aux oreilles et satisfont nos passions, plutôt que des philosophes qui s’efforcent de nous faire prendre conscience de notre ignorance et nous incitent à nous connaître nous-même. On a parlé d’un déni de réalité à propos de la crise sanitaire que nous connaissons. Peut-être ce déni indique-t-il que nous n’avons pas spontanément envie d’entendre un médecin ou un philosophe mais que nous préférons des discours comme ceux du cuisinier ou du sophiste. La question qu’il faut se poser est peut-être de se demander si au-delà du moment de la crise, où l’on se tourne vers le médecin ou vers le philosophe, nous ne risquons pas de très rapidement revenir à cette tendance naturelle.
Les philosophes doivent-ils se faire médecins ?
Cette question recevra une réponse différente en fonction de l’époque à laquelle elle est posée. Galien affirmait que le médecin devait se faire philosophe, mais il voulait d’abord indiquer par là la nécessité pour la médecine de s’appuyer sur des outils comme la logique, la méthode démonstrative, l’argumentation, pour constituer un véritable savoir et non une simple routine empirique. Autrement dit, il ne s’agissait pas du tout de dire que le philosophe serait là pour conseiller le médecin sur les bonnes pratiques d’un point de vue éthique (comme le montrent les travaux des spécialistes, cf. V. Boudon-Millot). Aujourd’hui, nous vivons à l’heure de la spécialisation. La philosophie est enseignée dans les facultés de lettres et de sciences humaines et sociales (SHS), la médecine dans les facultés de médecine, même s’il y a une demande de plus en plus forte pour intégrer les SHS au sein des études de médecine et une émergence très importante du champ des “humanités médicales”. Certains philosophes ont aussi une formation médicale, et cela correspond à une longue tradition depuis la IIIe République, dont on a des exemples : Georges Canguilhem jusqu’à Anne Fagot Largeault ou Anne-Marie Moulin. Mais ces philosophes-médecins ont suivi une longue formation, ils ne se sont pas “faits médecins” subitement ou pour les besoins de la cause. Canguilhem considérait la médecine comme une “matière étrangère” pour la philosophie. Cela ne veut pas dire que le philosophe n’a pas de rôle à jouer dans la réflexion sur la médecine. Mais il n’est pas là pour prendre la place du médecin. Son rôle ne peut être que beaucoup plus modeste. S’interroger par exemple de manière critique sur les termes qui sont utilisés pour présenter à la population le danger d’une épidémie, comme l’a fait Emmanuel Macron en parlant de “guerre”. S’interroger sur la situation d’incertitude dans laquelle nous place cette épidémie, où les médecins se retrouvent à devoir proposer des traitements sans avoir la certitude de leur efficacité ou de leur innocuité (le débat sur la chloroquin, Ndlr). Poser la question éthique de l’accès de tous aux traitements dans une situation de saturation des services de réanimation. Ces questions ne sont pas apparues subitement avec l’épidémie de Covid-19. Elles ont une longue histoire…
Que vient nous rappeler cette épidémie à la lumière de la philosophie ?
Je répondrai avec une phrase d’Adam Smith dans La Théorie des sentiments moraux, un texte de 1759 qui est écrit par celui qu’on présente comme le fondateur du libéralisme mais qui a aussi beaucoup réfléchi sur le rapport que nous entretenons aux situations des autres, aux aléas de fortune que nous pouvons observer, à la manière dont nous nous rapportons à la douleur, aux maux, maladies, ou au contraire au plaisir, et aux bienfaits soudains de la fortune. Dans ce texte, Smith imagine que “le grand empire de la Chine, avec ses myriades d’habitants” est soudainement englouti par un tremblement de terre. Il se demande comment un homme “doté d’humanité”, en Europe, n’ayant aucun rapport avec cette partie du monde, réagirait en apprenant cette nouvelle. Il explique qu’il exprimerait d’abord son chagrin, qu’il “ferait de nombreuses réflexions mélancoliques sur la précarité de la vie humaine et sur la vanité de tous les travaux des hommes qui peuvent ainsi être anéantis en un instant”. S’il va un peu plus loin, il réfléchira aux “effets que ce désastre pourrait produire sur le commerce en Europe et sur le négoce et les affaires du monde en général”. Mais, dit Smith, “une fois toute cette belle philosophie terminée, une fois tous ces sentiments d’humanité convenablement exprimés, notre homme retournerait à ses affaires ou à son plaisir, se reposerait ou se divertirait avec le même bien-être et la même tranquillité que si rien n’était arrivé. L’accident le plus frivole qui puisse lui arriver occasionnerait en lui un trouble plus réel. S’il devait perdre son petit doigt demain, il n’en dormirait pas la nuit ; mais il ronflerait avec le plus profond sentiment de sécurité malgré la ruine de cent millions de ses frères, pourvu qu’il ne les ait jamais vus ; et la destruction de cette foule immense semblerait l’intéresser bien moins que sa dérisoire infortune”. Il suffit de remplacer le tremblement de terre par l’épidémie que nous connaissons actuellement. Cela éclaire rétrospectivement notre indifférence (manifestée par les plus hautes autorités de l’État) vis-à-vis de ce qui pouvait se passer en Chine. On peut se poser la même question à l’égard de nos concitoyens qui sont actuellement victimes de l’épidémie. N’aurons-nous pas tendance à très vite revenir à ce qui nous concerne, à notre propre intérêt ? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire de cette expérience l’occasion de revoir durablement le type de rapport que nous entretenons avec nos proches, concitoyens, voisins, etc. ?
Que peut nous apprendre la vulnérabilité qui se fait jour dans notre société ? Que peut-elle nous révéler sur nous et notre civilisation ?
J’ai déjà parlé du fait que l’existence même de la médecine est le signe manifeste de la condition vulnérable de l’être humain. Nous avons tendance à l’oublier parce que nous vivons dans des sociétés très protégées (les sociétés européennes occidentales). Mais l’exposition actuelle des médecins, soignants, infirmières, de ceux qui assurent les activités vitales, l’alimentation, et qui se trouvent les plus exposés au risque de transmission (on a souligné le fait que cela concernait aussi plus souvent des femmes, comme les caissières de supermarché) met en relief que certaines catégories de population sont plus vulnérables que d’autres. Tout comme le confinement n’est pas du tout vécu dans les mêmes conditions par les privilégiés qui peuvent s’isoler dans leur maison de campagne et tenir des journaux de confinement, et ceux plus démunis qui vivent dans les cités et dans des appartements surpeuplés, privés parfois de connexion Internet, privés parfois aussi de revenus. Les étudiants font également partie de ces populations vulnérables.
En quoi consiste le défi lié à cette épidémie ?
Le défi à mon sens sera de ne pas oublier, une fois la crise passée, et de prendre le temps de réfléchir à nos modes de vie, au libéralisme, à la mondialisation, à notre rapport à l’environnement et aux animaux. Dans les années 60 au XXe siècle, l’inventeur de la bioéthique, Van Rensselaer Potter, affirmait que les questions d’éthique médicale devaient être posées à l’intérieur de ce qu’il appelait une “land ethic”, une éthique environnementale. Le défi est sans doute de prendre la mesure de ce rapport entre la survenue de maladies émergentes pandémiques et les transformations que nous avons fait subir à la nature, aux rapports que nous entretenons aux animaux sauvages et domestiques : c’est ce que montrent par exemple les recherches de l’anthropologue F. Keck sur les pandémies. Il est bien trop tôt pour tirer des leçons. Je crois surtout que le philosophe n’est pas là pour donner des enseignements. Plutôt pour poser des questions, sans avoir nécessairement de réponses d’ailleurs…
Que répondez-vous au philosophe italien Giorgio Agamben qui estime que “le terrorisme étant épuisé comme cause de mesures d’exception, l’invention d’une épidémie (offre) le prétexte idéal pour les étendre au-delà de toutes limites” ?
Je préfère éviter d’entrer dans des polémiques. D’abord je ne suis pas sûre que le terrorisme soit épuisé comme cause de mesures d’exception. Je vois même un certain rapprochement entre la situation de traumatisme que nous vivons actuellement et le traumatisme causé par les attentats qui ont eu lieu il y a cinq ans. Dans les deux cas, il me semble important de prendre le temps de la réflexion. Cela n’exclut pas la vigilance, comme celle à laquelle appelle G. Agamben. L’épidémie n’est pas ici inventée. Elle est bel et bien réelle. Ce qui peut être construit, amplifié, déformé, c’est notre rapport à l’épidémie, lequel peut devenir passionnel, se laisser entraîner par la crainte ou la confiance excessive. Si nous avons un quelconque pouvoir, ce n’est que là-dessus : sur le rapport que nous pouvons avoir à ce qui nous arrive, pour essayer de le penser, et pour interroger de manière critique nos rapports aux autres, nos modèles sociétaux, économiques, politiques… et le rôle que nous souhaitons donner à l’État dans la prévention de ce type de risque (et là encore je renvoie à la réflexion de Keck, qui attire l’attention sur le rôle des lanceurs d’alerte, sur un modèle de pouvoir fondé sur la traque, plutôt que sur le pouvoir pastoral qui institue une surveillance et un contrôle généralisé).





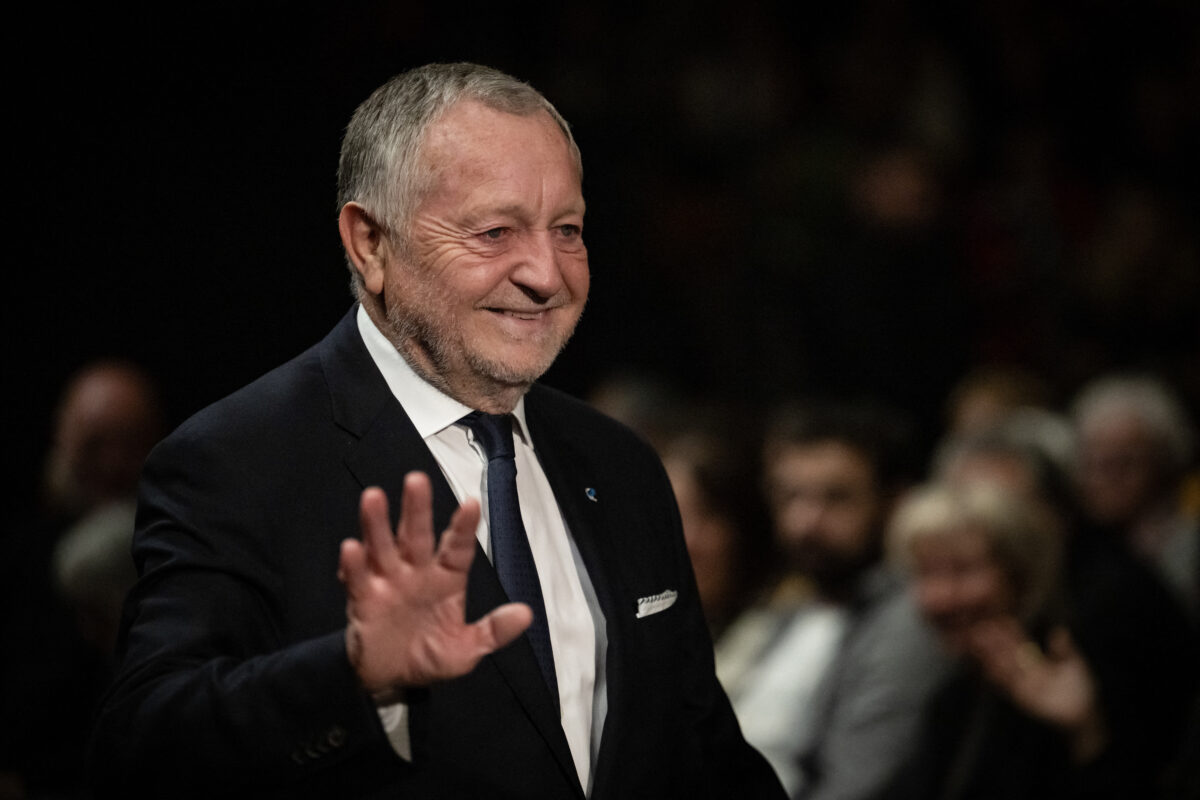
















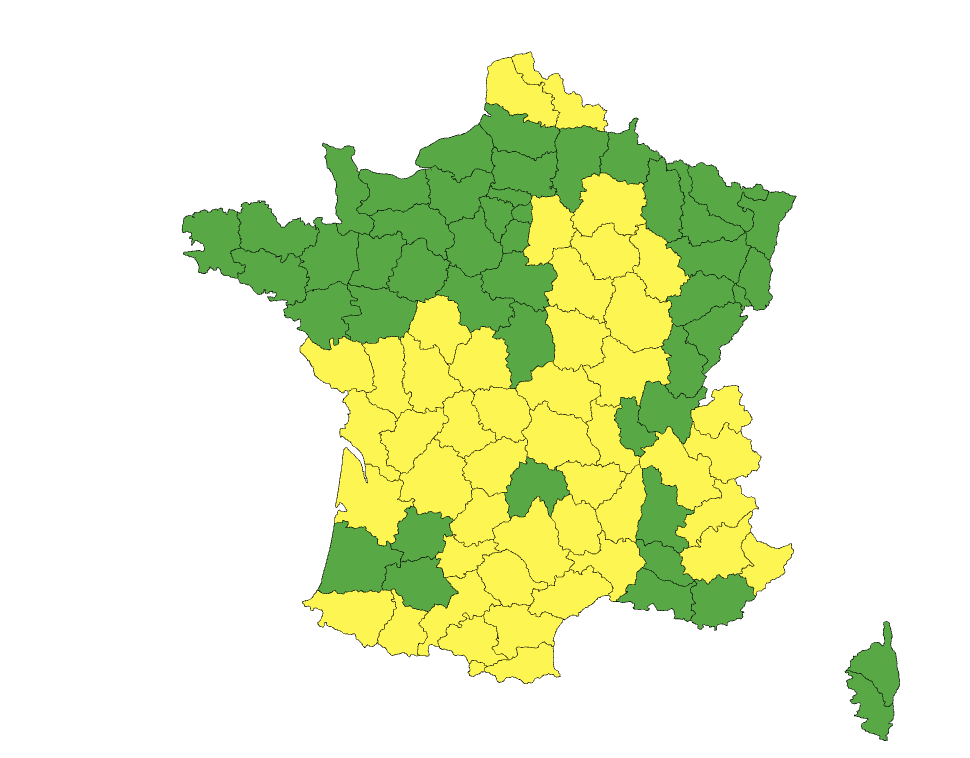

"Peut-être ce déni indique-t-il que nous n’avons pas spontanément envie d’entendre un médecin ou un philosophe mais que nous préférons des discours comme ceux du cuisinier ou du sophiste."
Face à la mort, nous employons différentes forme de survie. Le déni est l'une d'elle.
Face à l'impossibilité de remettre en cause ce qui fait le fondement de nos sociétés (le mercantilisme), nous continuons à faire des tours et des contours, afin de ne pas aller droit dans le mur. Mais le mur est toujours là et nous allons droit dessus.
L'ampleur du Coronavirus est finalement un choix sociétal.