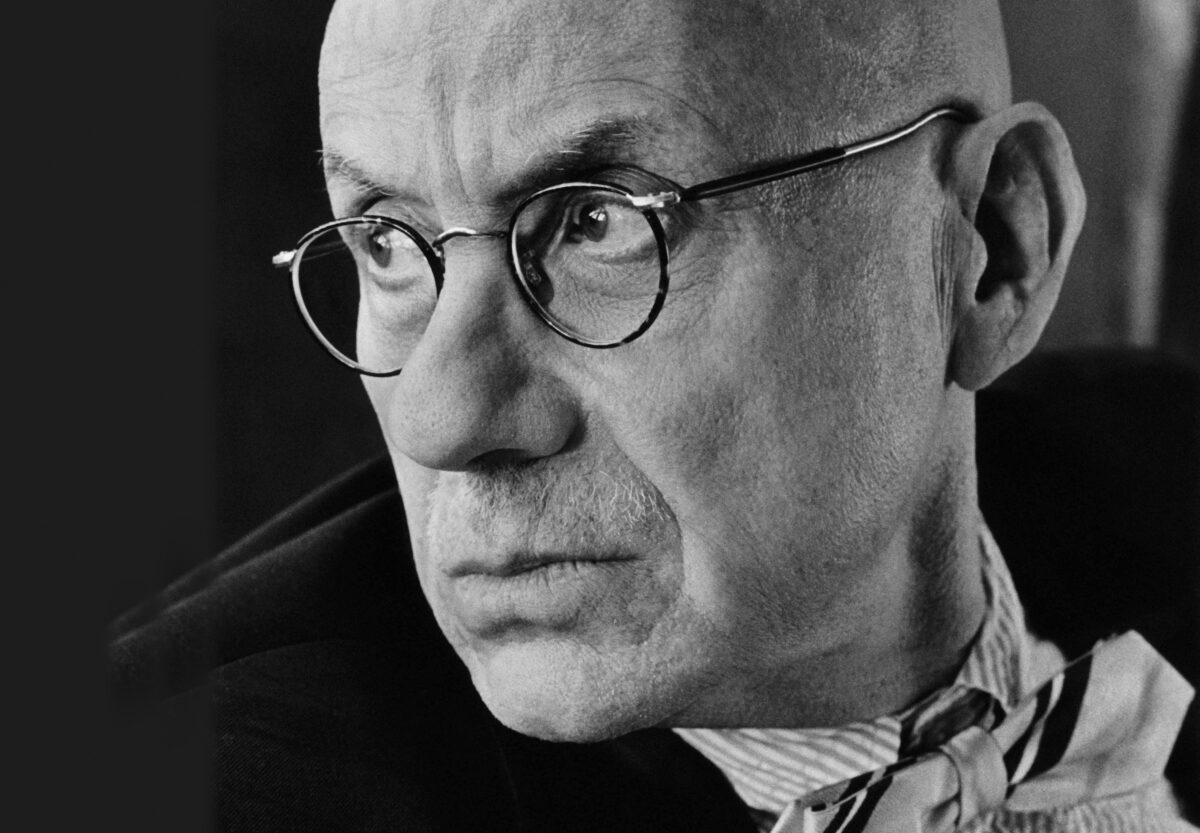Partenariat Lyon Capitale - École de journalisme de Grenoble
A partir d'aujourd'hui, lyoncapitale.fr publie 5 enquêtes réalisées par les étudiants de M2 de l'EJDG (ICM/Université Stendhal-Grenoble 3). Supervisés par un journaliste de Lyon Capitale, ils ont choisi des sujets complexes et mené librement leur enquête pendant plusieurs semaines.
Stopper la politique du tout carcéral en favorisant les peines en milieu ouvert, tel est le revirement politique que souhaite la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Pourtant, la part du budget consacrée à la construction et à la gestion des prisons pourrait freiner les ambitions de la ministre. En cause, la signature de projets en partenariat public-privé.
Elle l’a réaffirmé le jeudi 7 mars, Christiane Taubira souhaite favoriser les peines alternatives, en créant notamment une peine de probation, c’est-à-dire une sanction pénale totalement indépendante de la prison. Traduction : la ministre de la Justice veut faire des peines alternatives (travail d’intérêt général, bracelet électronique, suivi sociojudiciaire) des sanctions à part entière, au même titre que la prison, trop utilisée selon elle ces dernières années. Objectif : réduire la récidive en utilisant des dispositifs de réinsertion et in fine désengorger les prisons. Est notamment prévue l’abrogation des peines planchers et de la rétention de sûreté. D’autres idées, développées lors d’une conférence de consensus en février dernier, proposent par exemple une libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine ou la dépénalisation de certains délits. Un projet de loi devrait être présenté d’ici à la fin de l’année.
Du côté des syndicats, la mesure fait grincer des dents. “Tout ce qui existe déjà en probation n’est pas suivi. Les financements pour la réinsertion sont quasi inexistants. Ce qu’on n’avait pas avant l’instauration des peines de probation, on ne l’aura pas après”, assure Virginie Valton, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM). Car, pour mener à bien ces mesures, deux acteurs sont indispensables : les conseillers d’insertion et de probation (chargés de suivre les condamnés lors de leur réinsertion) et les juges d’application des peines. Or, le manque de personnel est déjà criant. Le ratio des personnes placées sous main de justice (c’est-à-dire suivies par un conseiller d’insertion et de probation, en milieu ouvert ou fermé) est de 82 par personnel d’insertion et de probation, alors que la norme européenne est de 60. Mais les disparités selon les départements sont grandes. “À Nantes, il y a un conseiller pour 130 condamnés”, témoigne ainsi Alexis Grandhaie, secrétaire national de la CGT Gardiens de prison. Et ce ratio peut monter jusqu’à 250, selon une fiche pédagogique rédigée lors de la conférence de consensus.
Les peines alternatives : une idée de la droite
Les mesures alternatives à la prison ne sont pas nouvelles. Alors que Nicolas Sarkozy vantait l’efficacité de l’incarcération, c’est sous sa présidence qu’a été votée la loi pénitentiaire de 2009 préconisant un recours plus massif aux peines alternatives pour lutter contre la surpopulation carcérale. À cette époque, les sénateurs socialistes s’étaient abstenus lors du vote de la loi, et les députés, quelques mois plus tard, avaient même voté contre. Depuis, le nombre de personnes purgeant un aménagement de peine n’a cessé de croître, passant de 2 403* à 10 693 entre 2005 et 2012. Une étude d’impact annexée à la loi pénitentiaire de 2009 préconisait la création de 1 000 postes supplémentaires pour réduire de 80 à 60 le nombre de dossiers suivis par les conseillers. Depuis, 262 conseillers ont été recrutés. Le budget 2013 prévoit l’embauche de 43 conseillers et 20 psychologues. On est bien loin des 1 000 créations de poste, qui ne permettraient en outre de combler que les manques d'effectif de 2009…
Si les peines alternatives se développent, c’est surtout grâce au recours au bracelet électronique. Selon un rapport du député socialiste Dominique Raimbourg sur la lutte contre la surpopulation carcérale, publié en janvier 2013, le bracelet électronique représentait 74 % des aménagements de peine au 1er janvier 2012, contre 29,5 % au 1er janvier 2005. Inversement, le placement à l’extérieur, jugé pourtant efficace pour réinsérer un détenu, est devenu de plus en plus rare, passant de 21 % au 1er janvier 2005 à 9 % au 1er janvier 2012. Les raisons ? Toujours selon le rapport de M. Raimbourg, cette évolution serait la “conséquence d’une érosion des financements alloués aux associations partenaires, chargées à la fois de l’accompagnement social, de l’hébergement, de la restauration, de l’emploi ou de la formation”.
Les places de prison en débat
Dans l’opposition, on n’est pas contre le renforcement des peines alternatives. Sébastien Huyghe, député (UMP) et corapporteur du rapport de Dominique Raimbourg, se déclare favorable au renforcement du personnel dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) préconisé par Dominique Raimbourg, ainsi qu’au renforcement du suivi des personnes placées sous bracelet électronique, ou à la mise en place d’amendes administratives à la place de sanctions pénales.
Le désaccord porte en fait sur la création de nouvelles places de prison. Sous la présidence Sarkozy était en effet prévue la création de 24 000 places de prison supplémentaires, via le NPI (nouveau programme immobilier), complété en 2012 par de nouvelles constructions. Lors du changement de majorité, ce plan a été abandonné en grande partie, puisque l’objectif est désormais de limiter le recours à la prison en privilégiant les peines alternatives. “Aujourd’hui, 82 000 peines sont en attente d’exécution. Donc on a véritablement besoin de ces places de prison supplémentaires”, défend pourtant Sébastien Huyghe. Réponse de la gauche : le rapport de Dominique Raimbourg pointe que 96,1 % des condamnations en attente d’exécution en 2011 étaient inférieures à deux ans… et pouvaient donc faire l’objet d’un aménagement de peine. M. Raimbourg avance un autre argument : “Si on développe les peines alternatives, ça veut dire qu’on va réduire un peu les peines d’emprisonnement et qu’à terme on va dégager un peu de moyens. Parce que l’alternative coûte beaucoup moins cher que l’emprisonnement.” En effet, selon une note publiée en juin 2012*, le coût moyen d’une journée de détention s’élève à 95 euros par personne, 47 euros pour une journée en semi-liberté, 40 euros pour un placement à l’extérieur et 5 euros pour le bracelet électronique. Reste que les moyens humains – donc financiers – pour assurer le suivi de ces mesures alternatives sont à ce jour loin d’être comblés. D’autant plus que l’investissement immobilier pénitentiaire de ces dernières années grève une part de plus en plus importante du budget, du fait notamment de la construction de prisons via des partenariats public-privé.
* “Prévention de la récidive : sortir de l’impasse”, note rédigée par un groupe de travail interdisciplinaire (magistrats, juristes, professionnels de l'administration pénitentiaire) coordonné par Jean-Claude Bouvier et Valérie Sagant.
Le gouffre financier des partenariats public-privé
À l’heure actuelle, 10 prisons sur 191 établissements pénitentiaires sont gérées en partenariat public-privé (PPP). Le montant des loyers de ces établissements s’élève à plus de 122 millions d’euros en 2013, soit une hausse de 7,8 % en un an. Et il ne va cesser d’augmenter jusqu’en 2035, pour atteindre cette année-là plus de 178 millions d’euros, selon les prévisions de la Cour des comptes. Ce coût pèse ainsi toujours un peu plus sur le budget de la justice, qui, dans le même temps, n’augmentera pas de manière substantielle si la reprise économique tarde encore.
Cependant, la part des loyers des prisons construites en PPP aurait été bien plus importante si le NPI initié sous la présidence de Nicolas Sarkozy avait été mené à son terme. Il prévoyait en effet de construire plus de trois quarts des nouveaux établissements (21 sur 27) via un partenariat public-privé. Autrement dit, le ministère de la Justice souhaitait déléguer à une entreprise privée le financement, la conception, la construction, l’entretien et la maintenance de ces prisons, ainsi que certains services tels que la cantine ou le transport des détenus (voir p. 4).
Un projet à plus de 16 milliards
Christiane Taubira avait annoncé dès sa nomination, en mai 2012, que “ce mode de financement n’était pas acceptable”. En cause, le coût exorbitant de ces partenariats. L’État aurait eu à débourser plus de 16,5 milliards d’euros en vingt-sept ans pour ces 21 établissements, selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2011. Cet investissement dépassait, à lui seul, le coût total des 145 projets engagés en PPP par les pouvoirs publics depuis 2005, qui s’élève à 12 milliards d’euros. De ce fait, entre 2011 et 2017, le budget de l’administration pénitentiaire aurait dû doubler pour couvrir les frais engagés dans le NPI.
Le ministère de la Justice n’a finalement maintenu que cinq des constructions prévues, dont quatre en PPP, et cela uniquement car il était trop tard pour faire marche arrière sur ces contrats. “Revenir à une maîtrise d’ouvrage publique ou à une conception-réalisation aurait demandé à peu près deux ans de délai en plus, des coûts supplémentaires et les dépenses liées à l’appel d’offres auraient été perdues”, explique Alexandre Bernusset, directeur opérationnel en charge des PPP à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ). Les contrats de partenariat relatifs à la construction des prisons de Valence, Riom, Lutterbach (lot A) et Beauvais (lot B) ont été signés en décembre dernier. Mais Lutterbach, qui faisait partie de la tranche conditionnelle du lot A, a finalement été supprimée du partenariat public-privé (conclu avec Spie Batignolles) pour revenir à une maîtrise d’ouvrage publique. Annoncée le 23 mai, la décision se faisait attendre depuis plusieurs mois.
La valeur totale (hors TVA) de ces marchés dépasserait 1,2 milliard d’euros : 960 millions pour le lot A et près de 271 millions pour le lot B, à rembourser d’ici 2040, selon le Bulletin officiel des annonces de marché public. L’État commencera à rembourser en 2016, quand les prisons seront construites. Ces loyers viendront alors s’ajouter aux quelque 3,5 milliards qui resteront à rembourser pour la construction des dix établissements déjà en service.
Un budget de plus en plus rigide
La part croissante du budget consacrée aux constructions immobilières va de ce fait limiter la marge de manœuvre du Gouvernement pour mettre en place de nouvelles politiques, notamment le développement des peines alternatives, qui nécessite des embauches de personnel importantes. D’autant plus que l’ouverture de ces nouvelles prisons exige l’embauche de surveillants supplémentaires. Ainsi, en 2013, sur les 293 emplois créés dans la justice pénitentiaire, 183 sont des postes de gardiens, ce qui explique en partie le nombre restreint (63) de créations de postes pour l’insertion et la probation. Pour Alexis Grandhaie, “s’il y a une baisse ou un maintien du budget tel qu’il est actuellement, le Gouvernement ne pourra pas développer sa politique de peines alternatives”, et ce malgré le coût moindre de ces peines par rapport à l’emprisonnement.
Car, en plus des loyers des PPP, le ministère de la Justice doit couvrir un certain nombre de dépenses auxquelles il ne peut se soustraire en aucun cas. Parmi celles-ci, on compte notamment les coûts liés à la gestion déléguée, la santé des détenus ou les subventions versées à l’École nationale d’administration pénitentiaire (Enap). Selon la Cour des comptes, ces dépenses incompressibles ont représenté 50 % du budget en 2011, contre 34 % trois ans auparavant. La part de ces dépenses étant en constante augmentation, le budget consacré à la justice pénitentiaire est de plus en plus rigide, limitant la mise en place de nouvelles politiques.
Néanmoins, certains se montrent encore optimistes et espèrent que la conférence de consensus de février dernier, en mettant sur le devant de la scène les peines alternatives, aura des répercussions budgétaires positives. “Mme Taubira était partie d’une situation assez isolée, mais elle a acquis un autre statut depuis, considère Alexis Grandhaie. On peut donc espérer une augmentation du budget du pénitentiaire. Ce serait un geste fort et indispensable pour montrer que le pénitentiaire est une priorité de ce gouvernement.” Malgré de nombreuses sollicitations de notre part, le ministère de la Justice n’a pas souhaité s’exprimer sur la question.
Mais Pierre Moscovici a fait fin avril une annonce qui met plutôt à mal ces espoirs. Le ministre de l’Économie a en effet indiqué que les dépenses baisseraient d’environ 13 milliards en 2014. Ces nouvelles restrictions ne devraient pas avoir d’impact sur les effectifs déjà prévus mais vont entraîner une baisse des crédits de fonctionnement. Les dépenses liées aux PPP ayant été scellées pour les trente prochaines années, ce sont les autres pôles de l’administration pénitentiaire qui risquent d’être touchés, y compris les SPIP. Alors, entre effet d’annonce et mise en place d’une politique de fond, Christiane Taubira devra peut-être attendre encore quelques années, le temps que la crise se dissipe. Mais, d’ici là, la situation carcérale pourrait s’aggraver… et la ministre et ses bonnes intentions, passer à la trappe.
* Comprenant la semi-liberté, le placement à l’extérieur et la surveillance électronique, d’après les données de l’administration pénitentiaire.
Les PPP : une étroite alliance avec le privé
Afin d’assurer sa mission de service public, l’État doit notamment construire et entretenir différentes structures (hôpitaux, universités, autoroutes, prisons…). Pour les réaliser, il fait appel à des prestataires publics ou privés via des contrats administratifs de plusieurs types : marchés publics, gestion déléguée ou partenariat public-privé.
Dans le cadre d’un marché public, l’État (ou la collectivité publique) est le maître d’ouvrage, c’est-à-dire qu’il (ou elle) décide des objectifs du projet, de sa localisation et assure les financements.
La gestion déléguée consiste quant à elle à confier à un opérateur – public ou privé – la gestion, dans une durée limitée, de tout ou partie d’un patrimoine (entretien, maintenance, services…).
Enfin, le partenariat public-privé (PPP), créé par l’ordonnance du 17 juin 2004, permet de confier en un seul marché la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et la gestion d’un équipement public. Le prestataire privé se charge également du financement du projet, en empruntant sur les marchés bancaires. L’État rembourse ensuite l’entreprise en lui reversant des loyers sur des durées allant de 15 à 40 ans. C’est souvent à cette échéance que l’État devient propriétaire de l’établissement. Jusque-là, l’entreprise privée est chargée d’entretenir l’établissement durant toute la durée du reversement des loyers.
Les avantages de ce contrat ? Les prestataires sont tenus de respecter les coûts, les délais, les objectifs de performance, et les risques sont partagés. Selon Alexandre Bernusset, directeur de l’APIJ*, “des gains économiques peuvent être réalisés, notamment sur l’exploitation et la maintenance des bâtiments”.
Les limites ? Jusqu’en 2010, l’État et les collectivités n’étaient pas contraints d’inscrire les loyers des PPP dans leur dette. Ainsi, 145 chantiers de grande envergure ont été lancés depuis 2004, endettant l’État pour les trente années à venir… Sans compter que la comparaison avec le coût d’un marché public est difficile : des études préalables sont bien obligatoires, mais elles sont difficilement accessibles. De plus, l’organisme chargé de valider ces études, la mission d’appui des PPP (Mappp), a aussi pour mission de promouvoir ces contrats… Drôle de mélange.
* Agence publique pour l'immobilier de la justice.