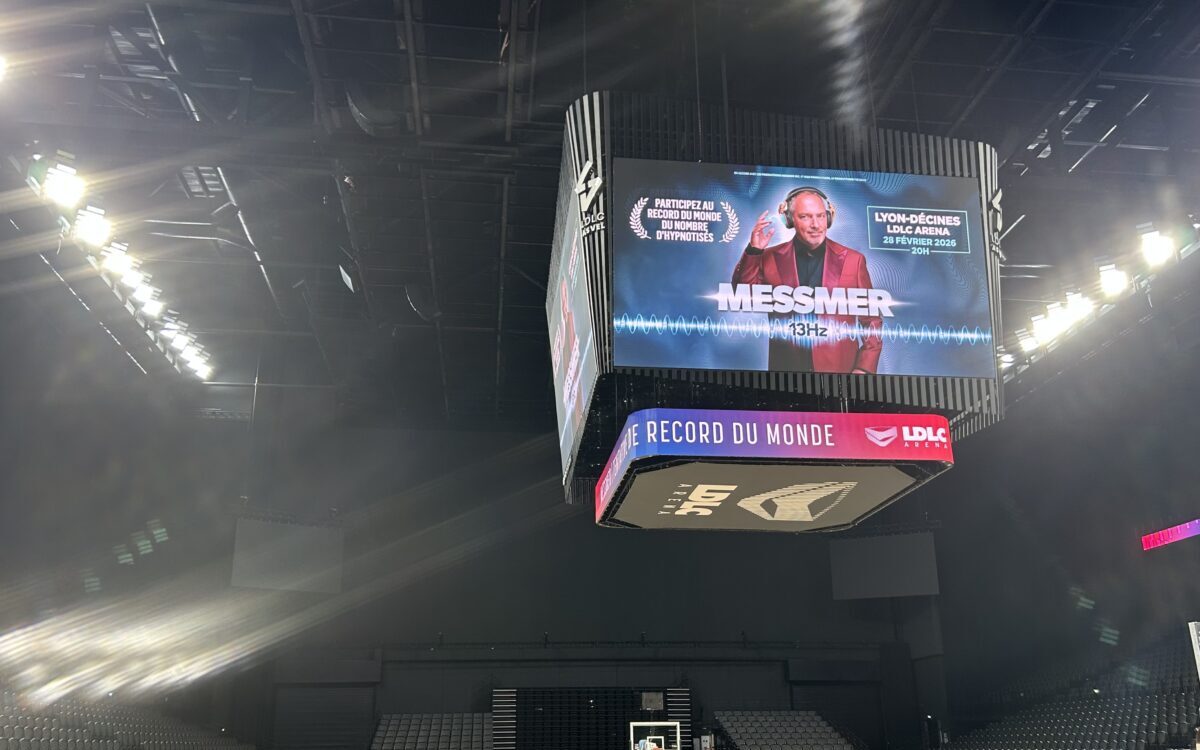23 novembre 1831. Les canuts prennent l’hôtel de ville de Lyon. Résolus à faire appliquer une hausse des tarifs, ces travailleurs inflexibles vont faire trembler l’État et la bourgeoisie. La révolte des canuts s’impose comme l’un des premiers grands mouvements sociaux du XIXe siècle, marquant toute l’Europe par sa puissance et sa volonté.
Lyon, 1831. La ville compte plus de 130 000 habitants, répartis sur la Presqu’île, les pentes de Fourvière et celles de la Croix-Rousse. Autour de la cité, les faubourgs de la Croix-Rousse et de la Guillotière continuent de grossir tandis que celui de Vaise se maintient. Depuis un an, le pays est sous la domination du nouveau roi Louis-Philippe, instigateur d’un régime libéral, propice aux bourgeois qui s’enrichissent sur le dos des travailleurs et petits patrons.
L’industrie de la soie est alors le poumon de la ville et de sa périphérie. Depuis 1801, le métier à tisser Jacquard a bouleversé les habitudes. Les travailleurs de la soie ont quitté le Vieux-Lyon pour s’installer à la Croix-Rousse, qui en sa qualité de faubourg est exemptée de taxes et qui est en outre protégée des inondations. Ils y ont fait construire des maisons avec d’importantes hauteurs sous plafond et de grandes fenêtres, pour pouvoir utiliser les imposants métiers à tisser. Les conditions de travail sont dures. Les journées de 15 à 18 heures sont monnaie courante tandis que les salaires restent inférieurs à 20 sous par jour, une misère pour l’époque quand le kilo de pain est vendu autour de 15 sous. Les usines sont encore rares, à l’exception de celle de l’île Barbe et ses installations de la Sauvagère. Fournisseurs de l’aristocratie sous l’Ancien Régime, les canuts ont été victimes d’une forte baisse de la demande avec la Révolution. L’Empire leur a permis pour quelque temps de retrouver une importante activité, et une réglementation des tarifs a même été acceptée. Dans le même temps, le 18 mars 1806, un “conseil des prud’hommes” a été créé à Lyon par Napoléon. Inspiré des pratiques lyonnaises existantes, il est censé résoudre les conflits entre les fabricants et les maîtres-ouvriers. Mais, dominé par les négociants, il ne fera que renforcer le sentiment d’injustice qui touche les canuts.
La solidarité
En 1831, la fabrique lyonnaise représente 1 000 négociants, plus de 8 000 maîtres-ouvriers et plus de 30 000 compagnons. Depuis la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, les corporations et syndicats sont strictement interdits. Cela n’empêche pas les canuts de régulièrement se rassembler et de trouver des manières détournées pour maintenir leur solidarité. Ainsi, dès 1825, ils ont fondé une société de secours mutuel permettant à ses cotisants d’être couverts en cas de maladie, de chômage ou d’accident. Preuve d’une vraie conscience de groupe, en 1831, le journal L’Écho de la fabrique fait son apparition. Les séances du conseil des prud’hommes y sont soigneusement relatées, dévoilant un peu plus le cruel déséquilibre en faveur des négociants. La situation va devenir intenable : une crise économique touche les travailleurs. Les salaires continuent de baisser tandis que la demande recule de près de moitié par rapport à celle de l’Empire. La poudrière n’attend plus qu’une allumette. Les fabricants, maintenant leurs profits sans répartir les richesses, vont l’allumer.
La première révolte des canuts
Le 18 octobre 1831, les canuts demandent la mise en place d’un tarif minimal. Dans un premier temps, les fabricants refusent. 8 000 canuts élisent des commissaires chargés d’aller réclamer une conciliation au préfet du Rhône, Louis Bouvier-Dumolard. Leur démarche aboutit, le 25 octobre, à une rencontre entre canuts et fabricants. À l’extérieur de la préfecture, 6 000 travailleurs manifestent en silence. En apparence, les deux parties parviennent à un accord. Mais, rapidement, certains négociants accusent le préfet d’avoir trahi le décret d’Allarde de 1791, qui stipule que l’État ne peut intervenir dans les négociations sur le travail. Ils lui reprochent également de ne pas respecter la loi Le Chapelier en recevant les délégués des ouvriers. Le 10 novembre, les négociants se tournent vers le Gouvernement, qui désavoue son préfet. La décision va révolter les canuts au plus haut point. Le sentiment de trahison se fait de plus en plus fort.
Le 21 novembre, la grève est générale. Elle se transforme rapidement en émeute. Réunis sur le plateau de la Croix-Rousse, les canuts se dirigent vers la montée de la Grande Côte. Une fois en bas, ils sont pris sous le feu des soldats, des morts tombent. Face aux balles, les émeutiers remontent précipitamment sur le plateau et appellent à prendre les armes. Des barricades sont érigées ; les fusils sont rares chez les canuts, mais leur inflexible détermination leur permet de faire pencher la balance de leur côté.
Plus forts que la Garde nationale
Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1831, les ouvriers de la Guillotière et des Brotteaux viennent aider les Croix-Roussiens. Ils sont rejoints par les travailleurs de l’usine de l’île Barbe. Le moral est requinqué. Le 22 novembre, la Garde nationale ne parvient pas à les contenir et se replie sur la Presqu’île. De violentes échauffourées ont lieu sur le pont Morand. Certains membres de la Garde nationale, eux-mêmes maîtres-ouvriers, rejoignent les canuts. Rue des Capucins, berceau des négociants, un face-à-face mortel s’engage. Les soldats sont désarmés. Les travailleurs prennent la Croix-Rousse, et le drapeau noir brodé de la devise “Vivre en travaillant ou mourir en combattant” est agité. L’émeute fait place à l’insurrection. Le télégraphe de Saint-Just est réquisitionné, empêchant les autorités de communiquer avec Paris. Cependant, alors qu’ils pourraient dévaster la ville, les canuts ne pillent que les armureries. Incapable de tenir la ville et voyant certains de ses hommes se retourner contre elle, la Garde nationale cesse le feu et se retire de la ville. Lyon est aux mains des canuts, qui feront tout pour la préserver.
La prise de l’hôtel de ville
Le 23 novembre, à 3 heures du matin, les canuts prennent l’hôtel de ville. Dans une missive adressée au garde des Sceaux, le procureur général avoue ne pas comprendre la situation : “Tous les contrastes se manifestent dans notre population. Elle a faim et ne pille pas. Elle s’est révoltée et n’a pas abusé de sa victoire. Elle a bravé ses magistrats municipaux pour combattre et, après le combat, elle est venue leur offrir sa force matérielle.” À cet instant, les revendications des canuts sont majoritairement économiques – mise en place du tarif –, mais la réussite fulgurante de leur soulèvement les place devant la nécessité d’une stratégie politique. Ils n’y sont pas préparés. À cette époque, il ne s’agissait clairement pas d’une remise en cause du pouvoir établi, mais bien de la puissante volonté de mettre fin à l’exploitation par les fabricants. À aucun moment, les canuts n’ont cherché l’anarchie ; des tours de garde ont d’ailleurs été organisés pour éviter les pillages, y compris dans les maisons de négociants pourtant haïs.
Porté par une minorité républicaine, un comité insurrectionnel est fondé : le conseil des seize, regroupant les chefs de section qui avaient été élus pour demander l’application du tarif. Mais ce comité ne parviendra pas à se révéler plus qu’un symbole. Une souscription est levée pour dédommager les familles de ceux qui ont trouvé la mort dans les affrontements. Le bilan de la semaine est lourd : 100 morts et 260 blessés parmi les militaires, 69 morts et 140 blessés du côté des canuts.
Début décembre, pensant qu’ils ont obtenu satisfaction, les canuts reprennent, en partie, le travail. Mais le roi Louis-Philippe ne peut laisser une telle provocation impunie. Son président du conseil, Casimir Perier, fait dépêcher 20 000 soldats, placés sous l’ordre du maréchal Soult et du fils du roi, le duc d’Orléans. Le 5 décembre, ils entrent dans la ville dans le calme, sans que le sang soit versé. Accusé d’avoir été trop conciliant, le préfet est limogé, tandis que le tarif minimum est annulé. Une centaine de canuts sont arrêtés. Seule une dizaine seront poursuivis, et ils seront tous acquittés. Ainsi s’achève la première révolte des canuts. Mais les plaies sont loin d’être guéries. La frustration est toujours là et la poudrière menace d’éclater à chaque instant. Heureux d’avoir eu au final gain de cause, les négociants ne se doutent pas qu’une autre insurrection couve déjà.
Négociant, maître-ouvrier, compagnon, canut : la hiérarchie de la soie
Plusieurs métiers gravitent autour de la soie. En haut de la hiérarchie, les dénommés “négociants”, “marchands” ou “fabricants” fournissent les matières premières, commandent l’étoffe aux maîtres-ouvriers et la revendent. Ce sont eux que l’on appelle les soyeux. Mais, contrairement à ce que leur nom indique, ils ne fabriquent rien.
Car la fabrication est le travail des canuts, maître-ouvriers ou chefs d’atelier. Ces derniers possèdent les métiers à tisser et en assurent le bon fonctionnement. Ils travaillent eux-mêmes sur l’un et confient les autres à des compagnons et apprentis. Maîtres-ouvriers et compagnons habitent souvent dans la même maison, qui accueille les unités de production. Pour l’historien spécialiste de la question Fernand Rude, ils étaient “les véritables prolétaires (…) En face du fabricant, les salariés que sont les chefs d’atelier et ses compagnons font bloc”. L'historien Bruno Benoit explique : "Les canuts sont des petits patrons qui emploient des compagnons qui logent chez eux. Ils sont les révélateurs d’une industrie qui meurt, un secteur qui laisse sa place à de nouvelles méthodes : la grande usine. Les canuts sont plus un crépuscule qu’une aube. Le petit patron, ce qui l’a mis en rogne en 1831, c’est que l’accord sur l’augmentation des tarifs, signé sous l’égide du préfet avec les marchands fabricants, n’avait pas été respecté. On est plus dans une démarche de l’économie traditionnelle du XVIIIe siècle que celle de la révolution industrielle". Des dizaines d’autres métiers dépendent du travail de la soie : teinturiers, lanceurs, brocheurs… Et les enfants ont aussi leur part de labeur.