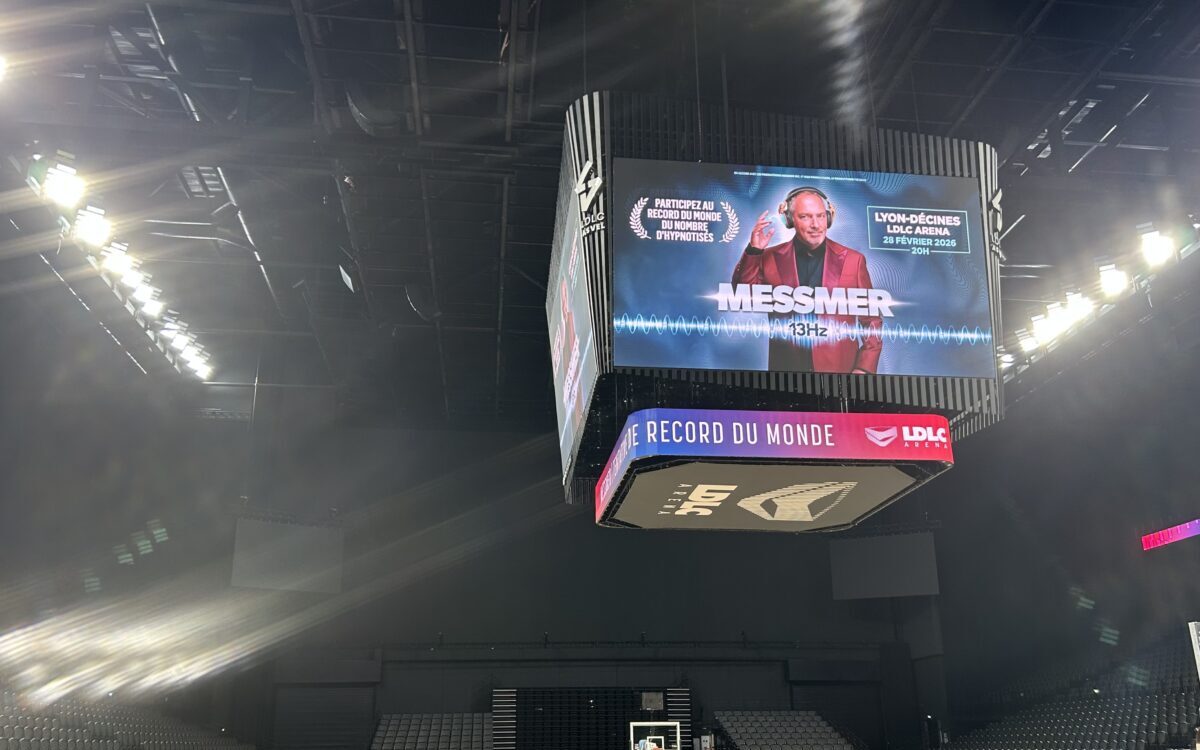Avec une compagnie constituée de danseurs algériens et d’autres venus de France, du Cameroun, d’Inde ou des Comores, Abou Lagraa explore la place du corps de l’homme et de la femme dans la culture musulmane. Superbe !
En 2008, le chorégraphe a choisi de retourner en Algérie pour tenter de retrouver ses racines. Avec sa femme, Nawal Aït Benalla-Lagraa, ils décident de créer un “pont culturel méditerranéen franco-algérien”. Ce “pont” aboutit à la création du Ballet contemporain d’Alger, constitué essentiellement de danseurs hip-hop, que l’on a pu découvrir dans Nya en 2010, puis dans Univers... l’Afrique. Durant tout ce temps, un important travail de formation a été effectué, dotant ces jeunes d’un niveau exceptionnel qui leur permet de danser du contemporain tout en gardant leur spécificité urbaine. Le désir du chorégraphe est de former des danseurs qui pourraient vivre de leur art en restant en Algérie, et participer ainsi au développement d’un élan culturel.
Avec 14 danseurs sur scène, sa dernière création, El Djoudour (Les Racines) exprime la fusion des deux compagnies qu’il dirige (la Baraka et le Ballet contemporain d’Alger) et interroge certains fondements de la société algérienne qui constituent son identité. Il pose son regard sur la place du corps dans la culture musulmane, un regard enrichi par les différentes cultures de ses interprètes.
Des corps qui revendiquent leur existence
La pièce s’ouvre sur un espace vide, une place (el fada, en arabe). Simplement délimitée au fond par des tonneaux en fer gris, elle accueille, aux côtés de la chanteuse algérienne Houria Aïchi, le beau solo de Nawal Aït Benalla-Lagraa qui, vêtue de rouge et jambes nues, semble poser devant nous le corps féminin dans ce qu’il devrait être : libre. Le ton de l’humanité de la pièce est donné. Tandis que la gestuelle de la danseuse est ondulatoire et en suspension, affirmant un corps fait de sensualité et de sexualité, d’autres femmes la rejoignent dans un souffle de douceur pour aussi prendre leur place.
Puis un groupe d’hommes arrive, installant des cadres qui vont scinder l’espace et mettre les femmes de l’autre côté. La musique métallique et lancinante d’Olivier Innocenti a déjà déployé sa chape de plomb. La danse est saccadée, avec des corps qui revendiquent leur existence par des frappes de pieds au sol et des bras qui appellent ou repoussent. Les hommes sont dans la démonstration masculine, convaincus de leur virile amitié. Mais ils chutent aussi. Abou Lagraa fait éclater ce semblant de cohésion en lâchant des solos qui révèlent leur fragilité, des corps prisonniers qui tentent l’échappatoire. Les femmes avancent dans le défi, elles ne fuient pas.
Il y a cette barrière infranchissable à laquelle tous se heurtent. Il y a cette jointure où le plexus – lieu d’émotions vitales – de chaque corps se heurte à la ligne. On est sur un premier champ de bataille, celui de la confrontation, de la dispersion et du désir maladroit. Plus loin, on sera dans ces rues d’Alger avec un groupe en cercle, constitué de femmes et d’hommes qui se mélangent, se tournent autour, s’observent. Ils ne se parlent pas, ne se touchent pas, mais ils savent.
--->
Des corps dans un débordement d’émotions
Avec l’intelligence qu’on lui connaît, Abou Lagraa est allé chercher en ses interprètes ce qu’il y a au-delà de la danse et qui fait qu’une fois de plus son travail nous relie à des êtres qui nous ressemblent et nous touchent. À ceux qui cherchent une logique narrative dans ce spectacle, il n’y en a pas. Les corps sont projetés comme autant de sensations, autant de réflexions sur ce que vivent ces individus dans leur société. Corps manipulés, corps social qui protège, empêche ou stigmatise. Femmes pantins ou transformées en mecs, corps sans identité. Duos où l’homme réussit à s’abandonner à la femme, qui lui révèle sa propre tendresse ; rencontres où l’homme ne sait que faire de ce corps féminin lové dans ses bras, qu’il va rejeter et finalement aimer. Il n’y a pas de logique apparente parce que les corps sont envahis d’émotions, soumis ou respectueux d’une tradition et du sacré, et pourtant intensément tendus les uns vers les autres. La danse est savamment pensée, qui dévoile une richesse d’écriture que nos sens se réjouissent de saisir.
Une seconde partie faite de chair
Depuis toujours, trois éléments accompagnent le travail d’Abou Lagraa : le ciel, la terre et l’eau. Dans cette seconde partie, les corps se libèrent et prennent des risques. La terre, déversée des tonneaux, symbolise la fertilité pour devenir un autre champ de bataille. Il est ce lieu où les corps se jettent sans retenue et font l’amour. La danse est écartelée par des pulsions et des impulsions qui provoquent des torsions de bustes élevant les corps sur leurs genoux. Des affrontements et des contacts surprenants se déroulent, et lorsque par moments la danse reprend sa place à la verticale, on assiste à de superbes portés où l’homme et la femme s’aident et redeviennent égaux, des solos hip-hop d’une grande élégance.
Les danseurs sont tous excellents, en dehors de tout formalisme esthétique, totalement investis. En regardant El Djoudour, on retrouve la splendeur de Cutting Flat et cette maîtrise de l’écriture chorégraphique autour du groupe et de la solitude avec ceux qui se croisent et se cherchent. L’on pense aussi à Où transe, un solo dansé par Abou Lagraa, car ici les danseurs sont tenus par un rythme intérieur scandé, semblable à celui de la musique et qui les transporte jusqu’au bout. La fin sur le piano, avec le duo de Nawal Aït Benalla-Lagraa et Oussama Kouadria, est bouleversante. L’eau purificatrice les mène vers l’apaisement, et le simple geste de se toucher par les bras prend ici une véritable dimension spirituelle.
-----
El Djoudour, d’Abou Lagraa. Lundi 8 et mardi 9 juillet, à 22h, au théâtre antique de Fourvière, Lyon 5e. Nuits de Fourvière 2013.