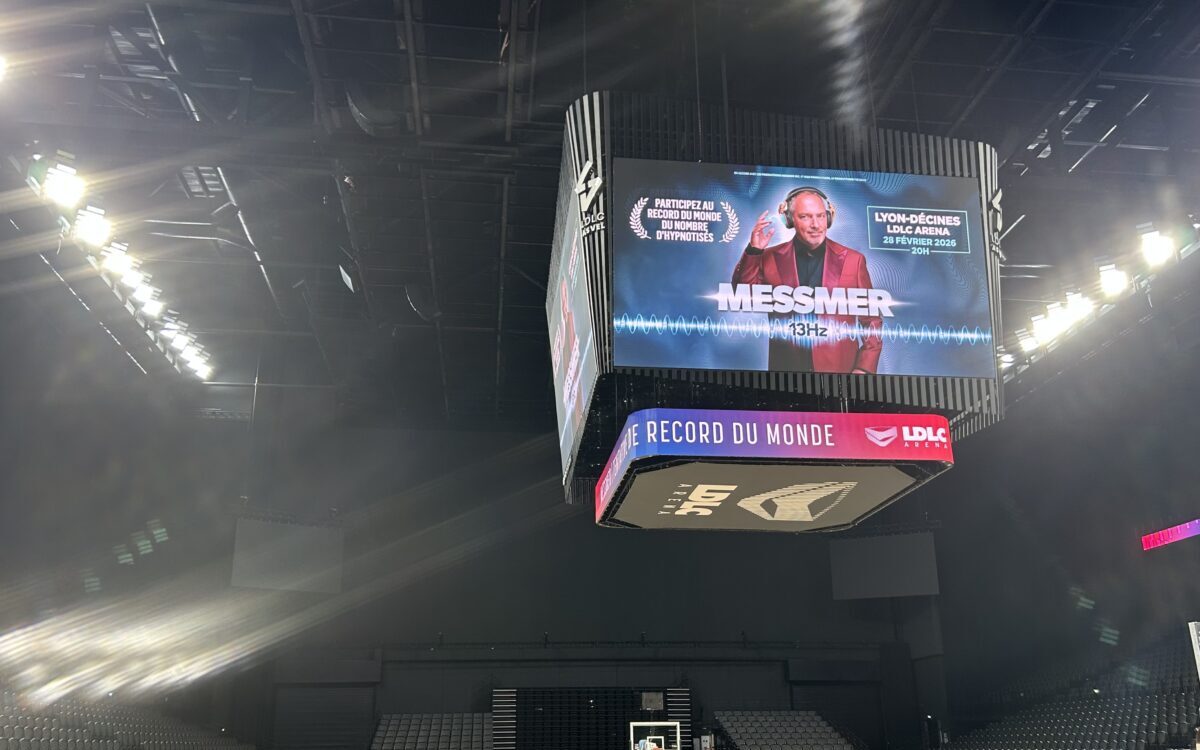CRITIQUE – C’était un pari audacieux que de mettre en scène la pièce, peu connue en France, du dramaturge anglais Howard Barker, Tableau d’une exécution. Il est tenu par Claudia Stavisky de bout en bout.

Le Tableau d’une exécution d’Howard Barker, dont la première mouture vit le jour en 1984 (dans une version radiophonique pour la BBC), offre une résolution dramaturgique passionnante à des questions philosophiques telles que la place dévolue à l’art dans la société, les rapports de l’art et de la politique, le pouvoir de l’œuvre artistique sur ceux qui la reçoivent… Des interrogations qui ont traversé le temps et résonnent encore fortement aujourd’hui. D’ailleurs, l’œuvre de ce dramaturge anglais né en 1946 se déroule dans la Venise du XVIe siècle.
“Une femme peintre, prénommée Galactia, se voit commander un tableau monumental en commémoration de la bataille de Lépante. Mais, au lieu de glorifier la victoire chrétienne face à l’Islam, elle peint la vérité de la guerre, dans toute sa violence, son atrocité, sa morbidité. Bien sûr, le tableau heurte ses commanditaires. Galactia est alors entraînée dans un bras de fer où les impératifs de l’art s’opposent aux mécanismes du pouvoir.” L’intrigue était ainsi parfaitement résumée par Claudia Stavisky, qui tournait depuis longtemps autour de l’idée de mettre ce Tableau d’une exécution sur son chevalet, la grande scène du théâtre des Célestins.
De captivantes ambiguïtés

Un pari audacieux, tant l’œuvre est difficile et complexe. Tant elle oblige le spectateur, s’il ne veut éviter l’ennui, à se passionner pour les sujets que l’on a exposés plus haut. Mais, si cet effort est accompli, il est alors emporté par la vivacité des dialogues, la profondeur des questionnements et la psychologie particulière des personnages. Ce n’est pas l’action ou des “coups de théâtre” qui retiennent l’attention – il n’y en a aucun et la pièce est statique –, mais l’intensité que parvient à insuffler Barker dans chacune des situations (savamment pimentées d’un humour sardonique) qui se succèdent, comme autant de variations sur un même motif.

On trouve tout d’abord la femme peintre (Christiane Cohendy, époustouflante) dans son atelier, brossant vigoureusement quelques parties de la gigantesque fresque dont elle a la charge. Tout entière dévolue à sa tâche, elle n’en accorde pas moins une attention irritée aux divers personnages qui l’aident ou l’interrompent dans son travail. Dans un décor un peu pesant qui évoque un vaste atelier, on pénètre ses pensées à travers les échanges vifs qu’elle a avec son commanditaire, le doge de Venise (Philippe Magnan, fascinant), son amant (David Ayala, aussi drôle que touchant), ses modèles (dont l’étonnant Geoffrey Carrey), sa fille, de vulgaires matelots ou un influent ecclésiastique.
À travers toutes ces interventions, les obstacles qui se multiplient, on mesure la difficulté à achever le tableau. D’autant que l’on voit bien l’obstination de la peintre à ne suivre que son inspiration, en l’occurrence montrer toute l’horreur d’une bataille, la souffrance et la mort plutôt que l’héroïsme des soldats. Un refus des concessions pas très éloigné d’une sorte de posture complaisante dans la rébellion, qui pourrait entraîner la peintre à subir des conséquences tragiques.
C’est justement l’intérêt de l’œuvre que de montrer les ambiguïtés des personnages, la part, toujours mêlée et changeante, de sincérité et de calcul personnel que recouvre chaque décision. Épaulée par une distribution hors pair, Claudia Stavisky parvient à mettre en exergue la complexité énigmatique de cette partition.