Une héroïne qui dégaine les mots aussi vite que son ombre, des interrogations existentielles sur le féminisme ou le récit doux-amer d'un apprentissage artistique… Ce sont les chemins empruntés par les trois auteurs qui sont les choix de Lyon Capitale pour cette rentrée littéraire.
Calamity Gwenn, “reu-sta” littéraire !
François Beaune, ex-Lyonnais désormais établi à Marseille, pourrait bien créer l’événement lors de cette rentrée littéraire. Son dernier roman est inspiré d’histoires vraies mais surtout d’une personne bien réelle, renommée “Calamity Gwenn”. Une foudroyante héroïne qui tchatche aussi vite, et juste, que son ombre.
“Si Dieu étai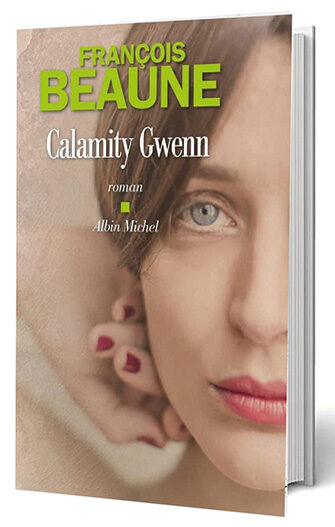 t vraiment amour, les gens continueraient d’y aller, à la messe. Et si Dieu était sexe, alors là, tous les jours.” Ainsi débute la longue confession de Gwenn, menée dans son vrai faux journal intime qui va de “Sextembre” (septembre) à “S’entendre” (toujours septembre, un an plus tard) en passant par “Opprobre” (octobre), “Navrante” (novembre), “Decevembre” (décembre), “Janveux” (janvier), etc. Signe que le réel dépeint est quelque peu déformé. Mais aussi que Gwenn sait jouer avec les mots, les triturer, les réinventer avec une forme de poésie gouailleuse, irrésistible. Entre verlan (une “reu-sta”, c’est une star, comme celle avec qui elle a une aventure, sexe, drogue et rock’n’roll), anglicismes, argot, néologismes, termes locaux (Gwenn est à la fois bretonne, marseillaise et parisienne). Elle a du style !
t vraiment amour, les gens continueraient d’y aller, à la messe. Et si Dieu était sexe, alors là, tous les jours.” Ainsi débute la longue confession de Gwenn, menée dans son vrai faux journal intime qui va de “Sextembre” (septembre) à “S’entendre” (toujours septembre, un an plus tard) en passant par “Opprobre” (octobre), “Navrante” (novembre), “Decevembre” (décembre), “Janveux” (janvier), etc. Signe que le réel dépeint est quelque peu déformé. Mais aussi que Gwenn sait jouer avec les mots, les triturer, les réinventer avec une forme de poésie gouailleuse, irrésistible. Entre verlan (une “reu-sta”, c’est une star, comme celle avec qui elle a une aventure, sexe, drogue et rock’n’roll), anglicismes, argot, néologismes, termes locaux (Gwenn est à la fois bretonne, marseillaise et parisienne). Elle a du style !
Gode cranté
Mais l’intérêt qu’elle suscite chez le lecteur ne se limite pas à la façon dont elle sait trousser une anecdote croustillante, retracer les épisodes saillants de son existence. Il y a la forme et il y a le fond, tout aussi passionnant. “La forme, c’est le fond qui remonte à la surface”, disait Victor Hugo. Son itinéraire est déjà peu commun ; après des études avortées, elle est devenue comédienne et accumule les castings, les petits rôles, les doublages… Tout en continuant de travailler dans un sex-shop de Pigalle. Pas forcément son rôle préféré même si elle sait mieux que personne vendre le gode cranté d’une taille telle qu’elle devrait interdire la pratique à quoi l’objet est pourtant destiné.
Et puis il y a aussi sa vie amoureuse, chaotique mais surtout libre. Ses amis, ses amants, ses emmerdes… Ses addictions…Tout y passe, retranscrit avec le style que l’on a évoqué mais aussi un humour, une autodérision qui confinent parfois au masochisme. Ainsi, Gwenn n’hésite pas à nous avouer comment l’oubli d’un tampon avait donné, bien involontairement, une odeur pestilentielle à son entrejambe. La gynécologue consultée eut la délicatesse de ne pas la sermonner... De toute façon, on voit mal comment on pourrait lui en vouloir de quoi que ce soit, tant elle est attachante et drôle. Et surtout présente, incroyablement vivante. En lisant le roman, on a l’impression qu’elle est juste à côté, qu’elle s’adresse directement à nous.
La raison de cette réussite tient à la façon dont François Beaune a su se glisser dans sa peau ; la faire parler, écrire. Le roman est en effet le fruit d’un long travail entre l’écrivain et son personnage (Rozenn Djonkovitch). L’amitié qui les unit, ainsi que des rencontres de travail, menées – joyeusement mais quand même – durant plus de quatre ans ; les journaux intimes de l’héroïne (dont certains passages ont été repris tels quels) ont produit ce roman exceptionnel, singulier mélange entre fiction et réalité. “C’est moi et ce n’est pas moi, explique Rozenn Djonkovitch. C’est moi en pire, c’est moi en mieux ! François a condensé, ‘rock’n’rollé’ ma vie !”
C. M.
• Calamity Gwenn, François Beaune, éditions Albin Michel, 352 p., 19,90 €.
Le point sur le point médian

Il est des moments comme ça où la foi vient frapper au coin de la condition humaine en une question existentielle : “Et Dieu dans tout ça ?” C’est un peu le même genre d’interrogation qui est venue interrompre Anne Robatel en pleine correction d’essais sur Orgueil et préjugés quand soudain, au détour d’une copie : un point médian. Et donc : “Et le point médian dans tout ça?”
“Tout ça” étant une existence de féministe mais surtout de femme, avec ce que cela suppose de convictions, d’acquisitions et de contradictions. Faut-il, pour régler la question du féminisme, un point médian, comme il faudrait un dieu pour statuer sur notre existence ? C’est à la volée ce qui vient cueillir quasiment en temps réel cette professeure d’anglais et de traduction à l’ENS de Lyon. Cela et comment se dépatouiller avec cette question qui ne va pas de soi concernant la littérature, son commentaire, sa traduction et plus largement le langage. Surtout quand le choix de guillemets pour encercler ou non un mot ou le choix du mot lui-même prête déjà à débat (ainsi du mot “paradigme” que l’auteure aime à utiliser quand sa mère pense que “façon de penser” suffit largement).
C’est en convoquant des figures aussi diverses que Virginia Woolf, Simone de Beauvoir (et deux visions totalement opposées du corps dans l’écriture et dans l’être femme, toutes deux imparables), Marlène Schiappa (un passage absolument savoureux sur le choix des mots, ce pilier aux pieds d’argile de la macronie rebattant la novlangue). Mais aussi Alice Zeniter, George Orwell (tiens donc), la figure d’un grand-père conservateur et royaliste ou d’un petit garçon, son fils (qui court à l’école en habit de chevalier enfilé sur des collants de fille) trop jeune pour être effleuré par les questions de conventions en général et de genre en particulier.
Et Dieu alors, au milieu de tout cela ? Anne Robatel le convoque lorsqu’il s’agit d’essayer de trancher la question de ce que peut désigner le mot “lecteur” dans un commentaire de texte sans recouvrir quelque question de genre (car pourquoi pas “lecteur.trice.s” ?), quel que soit le texte étudié par ailleurs.
Ainsi Anne Robatel choisit-elle de désigner son texte présentement en cours comme “écrit pour le ‘lecteur’, c’est-à-dire qu’il tend vers un point de vue universel et transcendant, un point de vue qui m’échappe et qu’on pourrait aussi bien désigner par le nom de ‘Dieu’, qui est peut-être justement ce que d’autres voudraient aujourd’hui désigner par un point médian, ou encore un néologisme au genre neutre, un néologisme qui reste à inventer”.
Cela vous laisse perplexe ? Cela tombe bien, c’est peut-être un pas de fait vers le féminisme car, dit Anne Robatel ; “être féministe, c’est être perplexe”. Face aux injonctions du féminisme comme à celles de ceux qu’il rend... perplexe.
K. M.
• Dieu, le point médian et moi, Anne Robatel, éditions Intervalles, 80 p., 8 €.
Mots en couleur
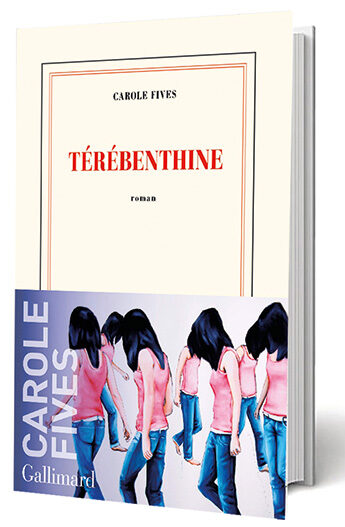 Comment naît un écrivain ? La question appelle mille réponses. Ou aucune. Concernant la narratrice de Térébenthine, à travers laquelle l’auteure Carole Fives (Une Femme au téléphone, Tenir jusqu’à l’aube...) raconte ses années aux Beaux-Arts de Lille, c’est en voulant devenir peintre qu’elle est entrée en écriture.
Comment naît un écrivain ? La question appelle mille réponses. Ou aucune. Concernant la narratrice de Térébenthine, à travers laquelle l’auteure Carole Fives (Une Femme au téléphone, Tenir jusqu’à l’aube...) raconte ses années aux Beaux-Arts de Lille, c’est en voulant devenir peintre qu’elle est entrée en écriture.
Au début des années 2000, la peinture est morte, partout l’on chante son oraison funèbre un sourire en coin, les artistes entrepreneurs, les chefs de chantiers conceptuels règnent sur le “marché”. Un marché dont les femmes constituent la portion congrue ou muette – celle qui pose de tout temps dans les œuvres, un statut de prétendue muse pour toute consolation.
Avec Lucie, l’excentrique pragmatique, et surtout Luc, peintre fiévreux que son art consume, avec qui elle forme un trio surnommé Térébenthine par les moqueurs, la jeune femme tente de résister, notamment aux profs qui n’ont que mépris pour les barbouilleurs, relégués dans les souterrains des Beaux-Arts comme aux oubliettes.
Mais c’est la peinture qui résiste : qu’en faire, comment, et que faire de soi ? C’est là que point l’écriture, là que les formes finissent par dessiner des mots sous le poil du pinceau auquel il pousse une plume. L’écriture serait une peinture sans artifices, sans logistique, sans matière mais qui incarne les mondes plus que le pinceau ne les trace.
Et surtout l’écriture est l’expérience de la solitude absolue. C’est soi avec soi et avec les mots au-dedans de soi. De là, le Je serai peintre de la narratrice, qui dévide un destin pour en crayonner un autre, est comme le Ceci n’est pas une pipe de Magritte ; la naissance de l’écrivain derrière le renoncement à l’art pictural trop soumis au diktat... du discours, cette langue convenue, officielle jusque dans sa dissidence, appauvrie à force de sophistication, à qui la littérature substitue la richesse de la langue et l’infinie palette de mots.
K. M.
Térébenthine, Carole Fives, Gallimard, 176 p., 16,50 €.



























